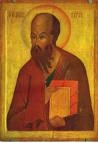19/01/2024
Étude n°4 Le Seigneur entend et délivre Psaume 121 (27 01 24)
Étude n°4 Le Seigneur entend et délivre Psaume 121 (27 01 24)
« Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d’un secours opportun » Hébreux 4.16
Observons le Ps 121, composé de deux strophes (1-4 : Dangers du voyage ; 5-8 : bénédictions invoquées sur ceux qui partent)
- Que signifie le titre « Psaume des Montées » ? A quelles occasions pouvait être chanté ce psaume ?
1-4 : Première strophe : Dangers du voyage
- Remarquer le changement de pronoms personnels entre les versets 1-2 et 3-4 : Quelle forme cela donne-t-il à ces versets ?
- V1 : Comment peut se comprendre le mot « montagnes », selon les différentes ponctuations données en français à ce verset ?
- Comment est nommé l’Éternel ? En quoi cela répond-il au verset 1 ? Quel sens donner à l’image du pied chancelant ? Qu’est-ce qui peut faire chanceler notre marche avec Dieu ?
- V3-4 : Quel mot apparaît ici et est répété ensuite 6 fois ? Sur quelles qualités de Dieu insiste-t-il ? Que représente Israël ?
5-8 : Seconde strophe : Bénédictions d’adieux à ceux qui partent
- V 5 : Que représente l’ombre pour les voyageurs ? Comment cela qualifie-t-il Dieu ? Qu’ajoute la mention « à ta main droite » ?
- V 6 : Physiquement que représentent soleil et lune ? Et spirituellement ?(Deut 4.19 ; 17.3 ; 2 Rois 23.11)
- V 7 : Qu’est le mal dont Dieu nous protège ? A quel mot est-il opposé dans ce verset ?
- V 8 : Quels sont les sens possibles des mots « départ et arrivée » ? (Deut 28.6 ; 1 Sam 29.6)
- Quelle assurance veut nous donner ce psaume ? (Héb 4.16)
Comprenons
Ce psaume est le deuxième du petit recueil de quinze psaumes qui portent le titre de Psaumes des Montées. Il s’agit de cantiques qui étaient chantés par les pèlerins se rendant à Jérusalem pour les grandes fêtes de Pâques, Pentecôte, Trompettes et Tabernacles. Jérusalem étant située sur une montagne de 1000m d’altitude, on comprend que les pèlerins parlent de « Montées »,  même si ce mot peut aussi désigner les degrés, les marches du Temple. Dans le psaume 120, le pèlerin a exprimé sa solitude d’homme de paix (v 7), sa détresse devant la perfidie et les mensonges des ennemis (v 2-6,), et son assurance qu’ils recevront de Dieu leur rémunération (v 4). Au psaume suivant, le pèlerin se met en route pour Jérusalem et se tourne vers son Dieu. Tout dans ce psaume peut être compris au sens premier, physiquement pour le pèlerin vers Jérusalem, mais aussi au sens figuré, spirituellement pour celui qui chemine avec son Dieu vers la Jérusalem céleste !
même si ce mot peut aussi désigner les degrés, les marches du Temple. Dans le psaume 120, le pèlerin a exprimé sa solitude d’homme de paix (v 7), sa détresse devant la perfidie et les mensonges des ennemis (v 2-6,), et son assurance qu’ils recevront de Dieu leur rémunération (v 4). Au psaume suivant, le pèlerin se met en route pour Jérusalem et se tourne vers son Dieu. Tout dans ce psaume peut être compris au sens premier, physiquement pour le pèlerin vers Jérusalem, mais aussi au sens figuré, spirituellement pour celui qui chemine avec son Dieu vers la Jérusalem céleste !
Première strophe v 1-4 :
V 1 : Lever les yeux est l’attitude du pèlerin qui monte à pied vers la montagne de Jérusalem. C’est aussi l’attitude spirituelle du croyant qui considère Dieu et s’appuie sur ses promesses et l’espérance de la cité céleste. Dieu n’a-t-il pas conseillé à Caïn de « lever les yeux » pour bien agir et se détourner de sa rancœur contre son frère et de ses désirs de meurtre (Genèse 4.7) ? Les montagnes étaient les lieux d’adoration des dieux pour les païens et pour les Israélites avant la construction du Temple à Jérusalem. Le texte hébreu n’ayant pas de ponctuation, deux possibilités s’offrent pour traduire ce verset. Si l’on ponctue le texte sans interruption entre les mots « montagnes » et « d’où me viendra le secours », on lui donne une forme affirmative : le pèlerin sait qu’en regardant à son Dieu (localisé « en haut ») il trouvera le secours contre les dangers de sa route. Si l’on fait de la phrase une interrogative : je lève les yeux vers les montagnes … (temps d’arrêt d’effroi) D’où me viendra le secours ? » (Interrogation craintive), les montagnes représentent alors tous les obstacles rencontrés sur une route difficile, devant lesquels on éprouve une grande crainte et on crie au secours !
V2 : Ce verset est l’affirmation parallèle à la première pour la préciser, ou bien la réponse à l’interrogation précédente : le secours se trouve en Dieu seul Tout-Puissant puisqu’il est le Créateur de l’Univers qu’il dirige à sa volonté. Il peut donc faire concourir au bien du pèlerin toutes les circonstances, bonnes ou difficiles de sa route (Rom 8.28).
V 3-4 : le changement des pronoms personnels et possessifs (Je, mon, dans les v 1-2 ; te, ton dans les v 3-4) donne au poème une forme de dialogue entre celui qui part (Je..) et ceux qui restent qui lui souhaitent bonne route. Le texte hébreu exprime en effet plus un vœu qu’une promesse. L’Éternel peut empêcher que le pèlerin trébuche dans son ascension de la montagne, ou spirituellement que sa foi soit hésitante et faiblisse devant les épreuves de la vie. L’Éternel est un « garde du corps », un gardien de la vie, fiable et fidèle car il n’est pas soumis aux fatigues humaines qui réclament sommeil et repos. C’est un « veilleur », attentif sans relâche à ses enfants. La répétition des mots dans ces deux versets insiste sur ces qualités de l’Éternel pour confirmer la confiance que l’on peut placer en lui. Au verset 4 la mention d’Israël donne au poème une dimension communautaire. Ce n’est plus l’individu qui a cette assurance mais le peuple tout entier !
Seconde strophe v 5-8 : Bénédictions sur le pèlerin
V 5 : Ceux qui restent bénissent le pèlerin en réaffirmant l’assurance de la protection divine sur lui. L’image de l’ombre est tout à fait appropriée dans ces pays où le pèlerin parcourait des routes sèches, sans arbre, sous un soleil brûlant. Comparer Dieu à l’ombre protectrice et bienfaisante, est propre à rendre la route du pèlerin plus facile. Cette ombre d’ailleurs n’est pas statique, elle accompagne le croyant dans toutes ses actions (la main droite est dans la Bible le symbole de l’action) car Dieu marche avec le pèlerin.
V 6 : Soleil et lune présentent physiquement un danger égal de « coups de soleil ou lune ». Il est difficile de rester sur ce sens premier pour parler de la protection divine. On préfèrera voir dans cette mention des astres qui éclairent la terre, un symbole des idoles, des faux dieux qui donnent une lumière spirituelle néfaste et mortelle spirituellement (Deut 4.19 ; 17.3 ; 2 Rois 23.11), contre lesquelles Dieu n’a cessé de mettre son peuple en garde !
V 7 : ce sens est d’ailleurs accentué par le mot « mal » que contient ce verset, mis en opposition avec le mot « vie » (faussement traduit par âme). Spirituellement le mal est par excellence la mort (spirituelle et physique) qu’entraînent la séparation d’avec Dieu (Gen 2.17) et l'idolâtrie. Regarder à l’Éternel, « lever les yeux vers lui » permettra au pèlerin de garder la vie éternelle tout le long de son chemin (Jean 3.16)
V 8 : Le psaume se conclut par une affirmation générale : Dieu est présent du départ du voyageur pèlerin jusqu’à son arrivée à Jérusalem, tout le long de la vie (de la naissance à la mort) de celui qui a choisi de voyager sous sa protection, de son départ spirituel (=sortie du monde impie = nouvelle naissance), jusqu’à son arrivée (= entrée) dans la cité éternelle, la Jérusalem céleste (Deut 28.6 ; 1 Sam 29.6 ; Matt 28.20).
Que l’assurance de la présence protectrice et attentive de notre Seigneur rende nos routes humaines et spirituelles remplies de paix, de joie et de reconnaissance, envers et malgré toutes les épreuves que nous traversons !
Questions pour une application dans la vie chrétienne
- Quelles expériences de la protection fidèle de Dieu sur notre vie pouvons-nous partager avec notre groupe ou nos proches ?
- De quelles idolâtries Dieu peut-il encore nous délivrer à notre époque si éloignée ou ignorante de l’adoration de Dieu ?
- Mémorisons ce psaume pour trouver réconfort et espérance dans les moments difficiles que notre monde nous fait traverser !
08:00 Publié dans Psaumes 2024 | Lien permanent | Commentaires (1)
12/01/2024
Étude n°3 L’Éternel règne Psaumes 8 et 93 (20 01 24)
Étude n°3 L’Éternel règne Psaumes 8 et 93 (20 01 24)
« L’Éternel règne, il est revêtu de majesté ! » Ps 93.1
Observons
Psaume 8 : - Quel est le ton général de ce psaume de dix versets ?
- Strophe 1 (1-3) : Qu’admire le psalmiste en Dieu ?
- Quel contraste contient le v3
- Strophe 2 (4-9) : Comment Dieu est-il qualifié ? Avec qui est-Il mis en contraste ? Comment est désigné l’homme ? Quelle portée messianique peuvent avoir ces versets 6 et 7 ? Quels dons l’homme a-t-il reçus de Dieu ? Comment se conclut le psaume ?
Psaume 93 : Que célèbre ce psaume de cinq versets ?
Strophe 1 (v 1-2) Que loue le psalmiste chez Dieu ? Quelles conséquences la terre en retire-t-elle ?
Strophe 2 (v 3-4) : Qu’est-ce qui s’oppose à Dieu ? Avec quel résultat ?
Conclusion v 5 : Qu’est-ce que la royauté de Dieu garantit à son peuple ?
Comprenons
Psaume 8 : Ce psaume frappe par son ton calme et majestueux à la gloire de l’Éternel, en contraste avec les deux psaumes précédents qui expriment le trouble et la détresse du croyant devant sa faiblesse, sa finitude (Ps 6) ou la violence du méchant (Ps 7). Ici nous avons une contemplation sereine et émerveillée des œuvres du Créateur. Le terme « Guittith » qui l’introduit indique soit un instrument de musique de Gath, soit un ton ou une mélodie de joie et de louange, comme dans les deux autres psaumes qui le contiennent (Ps 81 et 84).
Strophe 1 (v 1-3) : Le psalmiste loue le Seigneur pour sa magnificence et sa majesté dans la création entière, terre et cieux. En employant pour la première fois le pluriel du possessif « notre », il associe le peuple à sa louange.
V 3 Aux adversaires incrédules et réduits au silence, David oppose le babil des tout petits enfants qui par leur existence même témoignent de la puissance de leur Père le Dieu Créateur. De même Jésus opposera aux sages et pharisiens l’intelligence des enfants qui avec simplicité savent saisir la révélation divine. (Mat 11.25)
Strophe 2 (v 4-9) :" les perfections divines se voient à l’œil nu dans sa création" (Rom 1. 20) dira aussi Paul. L’univers chante la gloire de Dieu mais devant cette grandeur infinie, David s’étonne que Dieu prenne soin de l’homme mortel, qu’il a choisi pour être le maître de ses œuvres terrestres. Son titre de « fils de l’homme » rappelle d’abord son origine : il est tiré de « l’Adama » la terre. Plus tard il désignera le Fils de l’Homme, Jésus, Dieu incarné, annoncé par Daniel (7.13-14) comme devant recevoir « domination, honneur, royauté » sur tous les peuples.
V 6 : De peu inférieur à Dieu : la version grecque des Septante et Hébreux 2.9 traduisent le mot Elohim qui est un pluriel par « les anges ». Mais ce mot est employé dès Genèse 1 pour désigner Dieu, de façon générale, à côté de Yahvé, l’Éternel, JE SUIS, (Gen 2) nom propre de Dieu (Exode 3.14). Pour le psalmiste l’humain est en effet supérieur à toutes les autres créatures parce qu’il est créé « image de Dieu » (Gen 1.27), et il a reçu la mission de le représenter sur la terre en la « dominant » et la «gardant» (Gen 2.13). Devant la faillite de cette mission, Jésus est venu en tant qu’homme pour la remplir selon sa volonté : il a donné sa vie pour que l’homme pécheur soit rétabli dans le projet de Dieu. Prophétiquement, ce psaume 8 annonce la personne et l’œuvre de Jésus.
Le psaume se conclut comme il avait commencé par une louange à la magnificence de Dieu révélée par toute la création (Rom 1.20).
Psaume 93 : 5 versets
Ce psaume avec le précédent ouvre une série de louanges à la royauté de Dieu. Écrit peut-être après l’exil, au moment où la maison de David n’avait plus la royauté et vivait dans l’anonymat, ce psaume porte le regard du croyant sur le seul vrai roi de la terre, l’Éternel. Puisqu’il a puissance, majesté et éternité, il assure la stabilité de la terre qu’il domine (v 1-2). Elle ne chancellera pas malgré l’opposition et les tentatives violentes des peuples rebelles (Égypte et Babylone, pour le psalmiste), que symbolisent les flots agités des grandes eaux (Ps 2.1-2 et Apocalypse 17.15).
V 5 : Du fait de la royauté inébranlable de l’Éternel, ses lois (= « témoignages ») et ses promesses demeurent la Vérité-même qui donne à son peuple (= "sa maison") sa qualité de «sainteté » (= mise à part pour le service de Dieu). Le psalmiste pensait d’abord au Temple de Jérusalem où Dieu a voulu habiter parmi les hommes. Avec Jésus puis Paul, nous y voyons le temple du Saint-Esprit que sont notre cœur et ceux de l’assemblée des croyants, qu’il ne faut pas profaner pour en faire une « caverne de voleurs » (Mat 21.13) en tombant dans l’idolâtrie.
Questions pour une application dans la vie chrétienne
- Pour quelles qualités de Dieu pouvons-nous rendre grâce ?
- Dieu règne-t-il sur notre vie ? Comment cela s’exprime-t-il ?
- Quel espoir nous donnent ces deux psaumes ?
- Que demandons-nous en priant dans le « Notre Père » : « Que ton règne vienne ! » ?
08:00 Publié dans Psaumes 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)