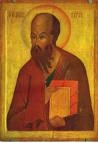12/09/2014
Étude n°12 Mort et résurrection Jean 11.33-34 (20 09 14)
« Jésus lui dit : Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort » Jean 11.25.
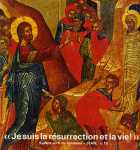
Observons Jean 11.33-34
Le contexte (v 28-33)
A quelle occasion a lieu la rencontre de Jésus et Marie ? (1-15)
- Qui sont les témoins de la scène ? v 31)
- Où a lieu la rencontre ? Quel reproche fait Marie à Jésus ? Qu’est-ce que cela révèle sur sa foi en Jésus ? (32)
Le texte (v 33-44)
Structure du texte
a) v 33-37 : diverses réactions de jésus et des témoins à l’approche du tombeau
b) v 38- 42 : Jésus devant le tombeau
c) v 43-44 : résurrection de Lazare
Questions
- Qui sont ceux que Jean appelle les « Juifs » ?
- Qu’est-ce qui trouble Jésus et le fait pleurer (v 33- 35) ?
- Quelle est la réaction des Juifs ? Que voient-ils en Jésus (v 36-37) ? Est-ce suffisant pour expliquer le « frémissement » profond de Jésus ? (v 38)
- Que veulent montrer les détails très concrets donnés sur le tombeau et l’état du mort ? (v 38-39)
- Que signifie ici la « gloire de Dieu » ? Quelle est la condition pour la voir ? (v 40)
- Qu’a d’insolite la prière de Jésus face au tombeau ? (v 41) Quel est le but de sa prière et de son intervention auprès de Lazare ? (v 41-42)
- Comment ordonne-t-il au mort de sortir ? (v 43)
- Dans quel état sort Lazare ? Que signifie pour le mort et pour les témoins de ce miracle l’ordre de Jésus de le délier et le laisser partir ? Pourquoi n’y a-t-il aucun mot prononcé par Lazare ?
- Quelles sont les réactions des sacrificateurs et des Pharisiens ? Quelles paroles prophétiques prononcent-ils à leur insu ? (v 45-53)
Comprenons
Le contexte : Jésus et Marie
Jésus a amené Marthe au seul fondement qui puisse la soutenir et la consoler : « Il est la résurrection et la vie » (v 25) ; il désire maintenant voir Marie pour la préparer aussi à ce qu’il va faire. Marthe prévient Marie en secret, pour qu’elle puisse avoir avec Jésus une entrevue particulière et sans témoins, comme elle-même.
Les Juifs consolateurs se méprennent sur le sens de la brusque sortie de Marie et la suivent pour l’entourer de leurs consolations humaines. Jean, dans tout l’évangile, désigne sous le nom de Juifs, ceux de son peuple qui restent incrédules devant Jésus. Ils ont des réactions très conventionnelles, très terre-à-terre, et ne perçoivent rien au-delà du visible. Leur incrédulité (v46) les pousse même à devenir la proie facile des manipulations des chefs religieux hostiles, au moment de la passion de Jésus (18.38-19.16).
La douleur de Marie semble plus désespérée que celle de Marthe : elle reproche à Jésus son absence pendant la maladie, mais n’ajoute rien comme parole d’espérance. Elle croit encore en Jésus comme guérisseur des malades, mais n’a aucune notion de sa puissance de résurrection, et se désole de la perte irrémédiable de son frère.
Le texte
Jésus et les Juifs (33-37)
v 34 : L’émotion de Jésus, ce frémissement intérieur répété (v 38), ses pleurs (v 35), sont différemment expliqués : ils viendraient
- de sa profonde compassion pour ses amies affligées, comme le comprennent les Juifs présents (v 36),
- ou de sa tristesse devant leur désespoir et leur incompréhension des promesses qu’il leur a faites,
- ou encore de son indignation devant les ravages sur ses créatures de la mort en général, et de son trouble intérieur à l’approche du combat terrible qu’il s’apprête à accomplir contre elle.
V 36-37 : Les Juifs soit sont émus par les larmes de Jésus, qu’ils interprètent comme des preuves d’affection pour Lazare, soit s’interrogent sur l’impuissance apparente de Jésus, alors qu’il avait guéri un aveugle-né. Leur étonnement s’apparente aux propos des magistrats, qu’entendra Jésus crucifié (Luc 23.35) : Il a sauvé les autres, qu’il se sauve lui-même, s’il est le Christ, l’élu de Dieu. Ils ne peuvent imaginer la puissance divine de Jésus, ni l’enjeu de la situation pour lui : Jésus se trouve confronté directement à la puissance mortifère du malin.
Lazare, dehors ! 38-44
Les tombeaux creusés dans le roc, étaient fermés par une pierre roulée devant ou sur l’ouverture. Jésus en présence du sépulcre agit avec autorité et commande aux hommes, comme il va commander à la mort. Marthe par son cri d’horreur, veut éviter la vue de la décomposition du corps de son frère. Elle n’a pas foi, à ce moment, dans une résurrection immédiate, sans renier pourtant sa foi dans le Sauveur. Jésus lui rappelle son affirmation (v 25-26), mais reprend pour cela les mots de son premier message (v 4). Il cherche par ce miracle à faire éclater la gloire de Dieu (v 4 ; 40), son amour et sa puissance de vie, afin que tous « croient que le Père l’a envoyé » (v 14-15 ; 42) pour leur salut éternel (v 25). Marthe, pourtant, ne pourrait pas la voir, ni la percevoir, si elle n’avait pas la foi, même face à son frère revenu à la vie ! C’est ce qui va se passer pour une partie des Juifs présents (v 46), et pour les chefs religieux endurcis dans l’incrédulité (v 47 et suivants).
L’action de grâces anticipée de Jésus illustre sa parole : « Lorsque vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l’avez reçue et cela vous sera donné » (Marc 11.24). Jésus n’avait sans doute pas cessé de prier et savait l’issue à la gloire de Dieu de ce combat contre la mort (v 4). Par les paroles suivantes (v 42), il donne le sens du miracle qu’il va accomplir : il doit être pour la foule un signe éclatant de sa mission d’Envoyé de Dieu, de Sauveur. C’est un témoignage rendu à la Vérité.
L’ordre donné à Lazare est le même appel donné par le Créateur pour faire venir au jour ses créatures (Genèse 1). C’est la Parole, pleine de puissance, qui donne Vie aux choses et aux êtres.
Malgré les bandelettes rituelles qui entouraient le mort, Lazare put se dresser et sortir du sépulcre. Il n’eut toute sa liberté qu’une fois « délié » par les témoins, sur l’ordre de Jésus. Peut-on y voir un symbole de l’aide demandée aux croyants auprès de celui qui passe par une résurrection spirituelle : il a besoin des autres pour affermir sa foi et être totalement libéré de l’emprise de la mort spirituelle ?
Si l’on parle encore de Lazare dans l’évangile de Jean en mentionnant sa résurrection et la haine contre lui qu’elle provoqua chez les Juifs (12.10-11), rien n’est dit sur ce qu’il éprouva ou put raconter de son expérience au-delà de la mort ! Si les visions de coma prolongé dont on parle actuellement avaient été si importantes pour la foi et l’espérance, qui d’autre mieux que Lazare aurait pu en parler ? Comme dans l’histoire du riche et du pauvre Lazare, le silence de ce Lazare, frère de Marthe et Marie, renvoie au seul fondement de la foi : la Parole de Dieu, les Écritures qui affirment l’inconscience totale dans l’état de mort, dont seul Jésus-Christ peut faire sortir par la résurrection.
Questions pour une application dans la vie chrétienne
Recherchez au fur et à mesure des étapes du récit, l’intention cachée des propos de Jésus, qui sachant ce qui va arriver, y prépare peu à peu ses amis. Il veut que derrière le miracle extraordinaire, ils distinguent l’amour de Dieu qui donne la vie éternelle à ceux qui croient en Christ.
Cherchez avec les membres de votre groupe tous les moyens de donner la vie, qu’ils connaissent : au sens propre, naissance, bouche-à-bouche, transfusion de sang, greffe d’organe vital, (cœur, foie, poumons, mœlle, etc...) ; Montrez leur signification possible au sens spirituel, et celui des rites (baptême accepté, sainte cène partagée) qui symbolisent l’entrée dans la vie éternelle.
- Quelle pierre (spirituelle) doit être ôtée de notre vie pour que Jésus nous ressuscite ? (l’incrédulité, le sentiment d’être indigne, d’être coupable devant Dieu)
- Quelles bandelettes (spirituelles) restent encore à détacher de nos vies, après que Jésus nous a ressuscités (habitudes néfastes : tabac, alcool, drogue ; rancunes tenaces, esprit de critique et de jugement des autres, préjugés, perception trop littéraliste de la parole de Dieu, etc.) Comme pour Lazare, il nous faut sans doute l’aide de nos frères et sœurs ou de spécialistes de la santé, pour nous enlever ces bandelettes, et cela peut prendre du temps, mais Jésus « achèvera l’œuvre de vie qu’il a commencée en nous » (Philippiens 1.6).
- Qui puis-je aider cette semaine à être délivré de ces « bandelettes » qui entravent la liberté de la vie en Christ ? Prions d’avoir le discernement des moyens et des besoins d’aide spirituelle dans notre entourage.
08:00 Publié dans Enseignements de Jésus | Lien permanent | Commentaires (0)
05/09/2014
Étude n°11 : Le sabbat, Marc 2.23 à 3.6 (13 09 14)
« Le sabbat a été fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l’Homme est maître même du sabbat » Marc 2.27-28.
Polyptique de Monbéliard 16è, les épis mangés le sabbat
Observons Marc 2.23 à 3.6
Deux parties distinctes à propos du Sabbat :
A : 2.23-28 : premier conflit à propos du sabbat : les épis arrachés :
a) 23-24 : Les Pharisiens scandalisés
b) 25-26 : Réponse de Jésus : David a enfreint la loi
c) 27-28 : Le Fils de l’homme est maître du sabbat
B : 3.1-6 : second conflit à propos du sabbat : la guérison de l’homme à la main sèche
a) 1-2 : malade dans la synagogue, les pharisiens épient Jésus
b) 3-5 : Question de Jésus sur le sabbat et guérison
c) 6 : Alliance contre Jésus
Questions d’observation :
A- 2.23-28
- Où se situe la première scène, avec quels personnages ? (2.1)Qu’est-ce que les Pharisiens interdisaient de faire le sabbat ? Pourquoi ? (2.2)
- Quelle est la transgression de David et ses gens ? Au nom de quoi transgressent-ils la loi ? Qu’avaient de « sacré » les pains de proposition ?
- Qu’en conclut Jésus sur le geste de ses disciples ? Que met-il au dessus de la loi du repos de sabbat?
- Pourquoi se déclare-t-il maître du sabbat (v 28) ?
B- 3.1-6
- Où se situe la seconde scène ? Quels en sont les personnages ?
- Qu’y a-t-il de curieux dans la présence d’un malade dans la synagogue ? Qu’est-ce que cela signifie sur cet homme ? De quoi souffre-t-il ? Quel symbole peut-on y voir ?
- Quelles sont les attitudes et les intentions des Pharisiens (v2)
- Que révèle l’ordre de Jésus au malade sur ses intentions profondes ? v 3
- Pourquoi la question posée aux Pharisiens ne rencontre-t-elle pas de réponse ?
- Quels sentiments agitent Jésus ? Comment les expliquer ?
- Que rétablit Jésus en guérissant l’homme ? Que veut-il enseigner aux Pharisiens ?
- Observez la progression de l’hostilité contre Jésus dans ces deux passages ? - Quelles sont les forces et les enjeux opposés dans ces récits de guérisons.?
Comprenons :
a) Les épis arrachés
La scène champêtre décrit l’attitude naturelle et pleine de liberté des disciples qui sur la route éprouvent de la faim, et se servent dans ce que la nature leur offre. Le silence de Jésus sur ce geste semble sinon une approbation, du moins de l’indulgence envers ceux dont il connaît le besoin. Il va se servir de cet épisode de leur vie courante pour enseigner le sens réel du sabbat.
Les pharisiens sont scandalisés par ce geste, non pas qu’il soit un vol du bien d’autrui (Dt 23.26), mais parce qu’ils l’assimilaient à un travail, une moisson interdite par la loi mosaïque (Dt 34.21 ; Ex 16.26-28). Jésus et ses disciples leur semblaient non seulement enfreindre la loi, mais surtout se mettre au-dessus de la loi de Moïse. C’est pourquoi Jésus va se référer à l’exemple de David, futur roi au moment où il se permit d’utiliser les pains consacrés, destinés aux seuls sacrificateurs, pour satisfaire un besoin vital pour lui et sa troupe. En prenant cet exemple, Jésus ne veut pas en faire un cas de jurisprudence, pour justifier un acte répréhensible selon la loi. En déclarant que le sabbat n’a pas d’autre fin que le bien (physique et spirituel) de l’homme, il veut faire comprendre que l’homme n’est pas soumis à une loi cérémonielle, aveugle et inhumaine. De plus Jésus rappelle l’histoire de David parce qu’il est de sa lignée. Ainsi, en tant qu’homme, de lignée royale, et en tant que Fils de Dieu, il peut se déclarer maître du sabbat. En se nommant le Fils de l’homme il fait allusion à Daniel 7.13 : il est l’homme par lequel se fera le jugement, le Messie qui a autorité sur les lois que Dieu a établies pour le bien-être de l’homme. Il n’abolit pas la loi mais l’accomplit parfaitement.
Jésus nous place devant le choix entre l’observation d’un rite cérémoniel qui asservit et la préservation du bien-être vital de l’homme (Mt 12.7) : « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Jésus interprète la loi selon l’esprit de cette loi, et non la lettre. Le sabbat est fait pour le bien, le repos, le développement intérieur, la guérison physique et spirituelle de chacun.
Les épis pourraient être aussi le symbole d’une nourriture spirituelle que les disciples n’ont pas reçue dans l’enseignement légaliste et la pratique conventionnelle des pharisiens de la synagogue, et qu’ils trouvent librement dans l’œuvre du Créateur et dans la présence compatissante de Jésus.
b) La guérison de l’homme à la main sèche (Polyptique de Montbéliard, 16è)
Cet épisode illustre le même principe que celui des épis : le sabbat est un jour de guérison. Il nous libère de ce qui nous dessèche par manque d’amour ou par culpabilisation, et de ce qui nous empêche d’agir ou simplement de vivre selon le plan de Dieu, libérés de l’emprise du péché. Normalement un malade n’avait pas à pénétrer dans le temple, ou même la synagogue. Sa main sèche ou paralysée, symbolise son incapacité à agir librement, comme tout le peuple soumis à l’autorité sans cœur des Pharisiens, paralysé par une culpabilisation permanente de leur part. L’homme à la main sèche vient chercher du réconfort malgré tout, et ne trouve de la part des pharisiens que le rejet et l’indifférence à ses besoins. Ils désirent par-dessus tout coincer Jésus sur son respect ou non de la loi du Sabbat. Jésus en répondant aux attentes du malade, donne une leçon de miséricorde aux pharisiens endurcis. Il annonce aussi le sens de sa mission, et insiste sur la valeur du sabbat dans cette œuvre de Dieu parmi les hommes.
Sa question toute rhétorique, puisqu’il en connaît la réponse, veut placer les pharisiens devant une évidence incontestable : s’il n’est pas permis de faire le bien le jour du sabbat, négliger le bien qu’on peut faire, ce serait faire le mal, pécher et même tuer, selon le principe que rappellera Jacques (4.17) : « si quelqu’un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché ». La loi demandant de sanctifier le sabbat, on ne peut le sanctifier que par un acte de salut, de guérison, de miséricorde envers le malheureux. En même temps, Jésus dénonce subtilement l’hypocrisie des Pharisiens, qui prétendent observer correctement le sabbat, tout en nourrissant ce jour-là des accusations et des projets de meurtre contre Jésus (v 6).
Cette liberté d’action de Jésus est insupportable aux responsables de tous bords, dérangés dans l’exercice de leur pouvoir religieux et politique sur les autres. De simples observateurs hostiles, ils deviennent des comploteurs meurtriers (Mc 12.13). Ils s’allient aux Hérodiens, Juifs favorables à la dynastie régnante des Hérodes, soutenus par les Romains, et occupant sans doute des postes importants.
Questions pour une application dans la vie chrétienne
- Qu’est-ce qui fait autorité dans ma vie et dans celle de l’Église ? Mes désirs, mes opinions personnelles, les principes, les règlements, la Parole de miséricorde et de liberté ? Comment cela se traduit-il dans mes relations à l’Église, à la maison, et au-dehors ?
- Le sabbat est-il un jour de libération pour moi et pour les autres ? Quel y est mon état d’esprit, quelles pensées m’habitent pendant cette journée ?
- De quoi ai-je besoin d’être libéré ou guéri aujourd’hui ? De quelle libération aussi mon voisin a-t-il besoin de ma part ?
- De quel œil est-ce que je regarde le frère ou la sœur qui n’observe pas le sabbat comme moi ou comme l’Église le demande ? Le considéré-je comme « perdu » ? De quel droit ?
08:00 Publié dans Enseignements de Jésus, Origines | Lien permanent | Commentaires (0)