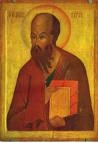03/10/2014
Étude n°2 : Le perfectionnement de notre foi, Ja 1.2-4 (11 10 14)
Étude n°2 : Le perfectionnement de notre foi, Ja 1.2-4 (11 10 14)
« Courons avec persévérance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l’auteur de la foi et qui la mène à la perfection : au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s’est assis à la droite du trône de Dieu ».Héb 12.2
Avant d’étudier le texte de Jacques, nous vous proposons la traduction littérale, établie par le pasteur Philippe Augendre, dont vous trouverez l’étude détaillée à la suite de notre note. Le texte grec a en effet été modifié par tous les traducteurs de nos Bibles, qui n’en ont pas respecté la structure grammaticale.
Voici ce que dit le grec :
« Tenez pour (sujet) de joie totale (le fait) de savoir que, quand vous rencontrez diverses difficultés, l’épreuve de votre foi produit la patience ».
Les mots entre parenthèse sont rajoutés pour une meilleure compréhension en français. En supprimant la conjonction « quand », les traductions ont complètement faussé le sens de la phrase et la pensée de Jacques !
Observons
- Par quel mot se terminait le verset 1 ? Comparez avec Actes 15.23 et l’ordre de Paul en Phi 4.4, dont le verbe est de la même racine.
- Où se retrouve la même idée au v 2 ?
- En quelles circonstances peut-on se réjouir selon Jacques ?
- Qu’est-ce qui est un sujet de joie ? Où se situe dans la phrase le complément d’objet du verbe à l’impératif ? Qu’en conclure sur son importance ?
- Par quoi ce complément d’objet est-il lui-même complété ?
- Quel est le fruit de l’épreuve de la foi ?
- Au verset 4, sur quel mot du v 3 Jacques rebondit-il ? Quelles répétitions contient ce verset 4 ? Que mettent-elles en valeur ?
- De quels perfectionnement et accomplissement s’agit-il ? voir Mat 5.48 ; Eph 4.13.
- Comment Jacques termine-t-il sa phrase ?
- Quel sens le croyant peut-il donner à l’épreuve de sa foi, à la souffrance des persécutions pour sa foi ?
Comprenons
La déformation du texte par les traductions a conduit à en faire une apologie de la souffrance absolument contraire à l’Évangile. Qui peut se réjouir sincèrement d’avoir des épreuves ? Ce dolorisme quand il n’est pas du pur masochisme, donne une image complètement faussée de Dieu, image trop courante qui éloigne de Lui bien des humains plongés dans les persécutions ou les difficultés. En revenant au texte grec original, nous retrouvons une pensée de Jacques fidèle aux enseignements de Christ.
Après une salutation :« Salut ! », qui n’est employée que par Jacques dans le Nouveau Testament, salutation d’usage dans le monde grec (= Réjouissez-vous !), mais qui prenait un sens plus profond et spirituel pour les chrétiens,
Jacques, par association de mots et d’idées, développe le sujet de joie que peuvent avoir les croyants persécutés par leurs frères Juifs.
La construction met au centre de la phrase le sujet de la joie : « sachant ». Les éprouvés peuvent se réjouir de savoir…et non de souffrir ! Le croyant n’est pas un « souffrant », mais un « connaissant ». Lorsque les épreuves arrivent, il peut s’appuyer sur leur connaissance du sens à donner aux épreuves de la vie. Par la Parole de Dieu et l’exemple du Christ (Héb 12.2), il sait que :
- ce n’est pas Dieu qui envoie l’épreuve, pour « voir » comment le croyant va réagir (Dieu le sait déjà et Il n’est pas sadique !). Jacques le dit plus loin : « Dieu ne tente personne ! » (1.13, éprouver et tenter traduisent le même mot)
- pour que le croyant supporte l’épreuve, Dieu qui est amour, envoie (montre, prépare, donne) le moyen d’en sortir (1 Cor 10.13),
- ces difficultés de la vie terrestre soumise à l’adversaire deviennent pour le croyant des occasions de témoigner de sa foi, de son attachement à Christ, le Fils de Dieu. (Voir "l’épreuve de l’épée" dans le jugement de Salomon (1 Rois 3.25-27), qui va permettre aux deux mères de révéler le fond de leurs cœurs)
- les épreuves sont pour le croyant un moyen d’épurer leur foi de toutes les fausses croyances inutiles qui ternissent l’image qu’il se fait de Dieu (1Pie 1.7) ;
- Ces afflictions enfin exercent la patience ou (l’endurance) du croyant qui est dans l’attente, le désir, l’espérance de la venue de Dieu dans sa vie et dans l’histoire du monde
Or (plutôt que « mais » qui marque une trop forte opposition) « cette patience a une œuvre parfaite à accomplir »(v 4) : dans le cœur du croyant, c’est de l’amener peu à peu à croître, « jusqu’à la stature parfaite de Christ, à l’état d’homme accompli », dans la maturité de sa foi et la justesse, la droiture de sa pratique (Eph 4.13).
C’est la connaissance de ce processus et de ce sens de l’épreuve qui remplit le croyant éprouvé de joie et de confiance en Dieu, dont il sait la volonté de tout faire concourir à son bien (Rom 8.28).
Pouvoir donner un sens aux difficultés incompréhensibles et même aux persécutions injustes pour la foi, est un privilège, une grâce de Dieu (1 Pie 2.20-24) qui nous permet ainsi de marcher sur les traces de Christ, « les yeux fixés sur Lui », de sorte que nous sommes « transformés en la même image » par l’œuvre de son Esprit en nous (2 Cor 3.18).
Puissions-nous tous nous en souvenir dans nos épreuves, pour faire rayonner la gloire de Dieu !
Questions pour une application dans la vie chrétienne
- Quelles sont mes réactions lorsque je suis atteint(e) par le malheur ? ou lorsque je vois souffrir des proches ou des frères dans la foi ?
- Comment transformer ma révolte, mon indignation justifiées en actions positives pour mon entourage et pour moi ?
- La patience revient-elle à tout accepter passivement, avec fatalisme ?
- Sur quelles paroles ou exemples de Jésus puis-je m’appuyer pour supporter mes épreuves ?
- Comment faire de mes difficultés des occasions de témoigner de ma foi et de mon espérance en Christ ?
Étude de Philippe Augendre (Bibliothèque de la Faculté Adventiste de Théologie, Collonges sous Salève, F 74160)
Beautés de Dieu (11)
La révélation de Dieu
Le dire et le vouloir-dire du texte
« Tenez pour (sujet de) joie totale (le fait) de savoir que, quand vous rencontrez diverses difficultés, l’épreuve de votre foi produit l’endurance » (Ja 1.2,3)
Reprenons les règles d’interprétation déjà vues avec un exemple concret. L’étude plus approfondie d’un passage biblique nous acheminera vers deux autres importantes règles d’interprétation.
Le passage de Ja 1.2-3. est une clé de l’expérience chrétienne. Mais dans les versions habituelles (Segond, NBS, Darby, TOB, Bayard, etc.) le sujet interpelle. N’est-il pas choquant, voire révoltant de considérer comme une joie totale le fait d’avoir des tentations ou de souffrir ? Le christianisme serait-il un masochisme ? Ce texte dit-il cela ? Dans l’esprit de la règle 1 sur la prière et la recherche de l’inspiration divine reprenons les règles déjà énoncées.
La règle 2 précise : « reconstituer le texte original aussi exactement que possible ». Celui-ci ne pose pas de problème spécial mais il est difficile à rendre en bon français car les syntaxes grecque et française ne sont pas les mêmes.
La règle 3 ajoute : « remettre le texte à étudier dans son contexte ».
a) Le contexte global (R. 3a) est évidemment celui du N.T. Le v. 1 ne présente-t-il pas l’auteur comme serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, lequel est mentionné treize fois dans cette courte épître ? Pourtant …
b) Le contexte général (R. 3b) nuance le propos précédent. Si le livre, d’un grec recherché, est fondamentalement chrétien, il est hébraïque dans son style (rythmes poétiques, nombreux proverbes/paraboles (mâshâl ) typiques de la littérature de la Sagesse). Proche des dires de Jésus, comme le sermon sur la montagne, c’est le plus vétéro-testamentaire du N.T. L’auteur pense en hébreu. Ainsi le terme « patience » (grec hupomonê, v. 3). veut dire « endurance », « tenir ferme sous le fardeau ». Mais ce mot grec ne traduit pas, dans la LXX, les racines hébraïques de « supporter[1] », « se tenir debout[2] » ou « demeurer ferme ». Il exprime plutôt l’espoir, l’attente, la tension vers[3], ce qui enrichit la notion.
Le contexte général nous dit aussi que l’Epître est destinée à des gens dans la dispersion, en souffrance. C’est un parcours de sagesse (1.5 ; 3.13,15,17) allant de la patience/endurance/attente (1.3) à la patience/grandeur-de-cœur/longanimité[4] (5.10). D’où la vigueur du début de l’Epître qui aborde une réflexion majeure. Il ne s’agit pas seulement de l’espérance de la gloire à venir ; c’est une vie au quotidien dans un monde de lutte et de souffrance. Loin d’attitudes masochistes ou stoïques, le sens donné à cette existence dans les difficultés sera la pierre de touche, la preuve, de toute l’expérience chrétienne.
c) Le contexte large (R. 3c), le paragraphe contenant notre texte) va jusqu’au v. 12[5]. Il introduit, face au doute ou à l’orgueil, le sujet de sa lettre : une sagesse non pas terrestre ou théorique mais divine et pratique.
d) Le contexte étroit (R. 3d) est la longue phrase des vs. 2 et 3.
Décortiquons-la au point de vue grammatical pour s’assurer qu’elle fait un tout, pour comprendre sa structure et en déduire une traduction plus satisfaisante. Traduite mot à mot on y trouve cinq propositions : « 1. Tenez pour toute joie | 2. mes frères | 3. quand vous rencontrez diverses difficultés | 4. sachant | 5. que l’épreuve de votre foi produit l’endurance. » La proposition n° 2 est une incise riche de sens mais sans incidence sur la phrase. La n° 1, à l’impératif, est la principale. En tant que telle, elle ne se suffit pas à elle-même (à la différence d’une pr. indépendante). Son verbe (considérez/tenez pour) a besoin, afin qu’on sache de quoi il est question, d’être complété. C’est ce que fait le participe présent n° 4 et sa subordonnée n° 5. La n° 3 précise (circonstancielle de temps : « quand ») dans quelles circonstances il est possible de « tenir pour ». La n° 4 : « sachant », placée au centre de la phrase, à la mode hébraïque, est la plaque tournante de la pensée. C’est elle qui, réduite à un participe présent, est le véritable complément d’objet[6] précisant de quoi on doit se réjouir. Elle introduit cette « connaissance », elle aussi très hébraïque, qui fait que, même dans des conditions négatives, peut se développer la joie. L’emploi du participe présent en français exprime une action simultanée au verbe de la principale qu’il complète. L’usage en grec du participe présent, souvent utilisé comme nom, est encore plus courant et plus fort. Il exprime une manière d’être, une disposition personnelle qui non seulement escorte le verbe principal mais constitue le premier temps de l’action[7]. En clair, le croyant, est d’abord « sachant ». C’est en fonction de cela que dans un second temps de perception des choses, il « considère » celles-ci d’une manière neuve. Mais sachant quoi ? La n° 5, complément d’objet direct du participe, répond à cette question : le chrétien sait que… l’épreuve de la foi produit...
Passons maintenant à l’étude du texte lui-même avec la 4e règle : « donner aux termes de la Bible leur sens le plus évident ». Nous avons déjà donné le sens de quelques mots. Les vocables les plus importants, sur lesquels il nous faut nous arrêter sont ceux de tentations/difficultés (épreuves) (v.2) d’une part, et d’épreuve (v.3), d’autre part. Fait significatif, l’original a deux mots différents. Que veulent-ils dire ? Question complexe pour deux raisons :
a) la langue analogique donne à chaque mot une pluralité de sens qui peuvent évoluer avec le temps,
b) l’usage fait que les mots « difficulté », « tentation », « épreuve », quoique différents, ont des sens se recouvrant largement, dans les originaux comme dans notre langue.
Le premier, peirasmoi[8] veut dire tentations et surtout difficultés. La traduction par « épreuve » ne peut être retenue qu’à condition de donner à ce mot le sens large de « mal subi » mais cela introduit alors une confusion regrettable avec le mot suivant. Ces ennuis, peines, afflictions que rencontre tout homme sont de toutes natures : vous en verrez « de toutes les couleurs[9] ».
Le second, dokimion[10], veut dire épreuve, non dans le sens communément employé de malheur ou d’adversité, comme le fait peirasmoi, mais au sens positif ; c’est l’expérience-examen, ce qui démontre une valeur ou une capacité, la mise à l’épreuve. Ce sens se retrouve dans des expressions comme l’épreuve/examen du bac ou une épreuve sportive. Ici, il s’agit bien entendu de l’épreuve de la foi victorieuse qui comme l’or « éprouvé » par le feu, dénote un croyant véritable, éprouvé, c’est-à-dire sûr, sans être nécessairement en souffrance. Afin d’éviter tout malentendu, je précise que c’est dans ce sens strict que j’emploierai ce mot.
*
Je ne m’arrêterai pas sur la 5e règle : déterminer le sens du texte. C’est manifestement ici le sens littéral ou grammatical. Énonçons maintenant les 6e et 7e règles relatives à l’acte de lire, qui est comprendre le dire du texte et découvrir le vouloir dire de la Parole.
6e règle : établir le dire du texte
Ce n’est pas la difficulté qui est objet de joie[11], c’est le « sachant », le discernement fécond que donne la foi, de ce qu’elle produit. Pour moi le texte dit (voir la traduction en exergue) : « mes frères, quand vous rencontrez soucis et difficultés, cela peut être une expérience victorieuse de foi engendrant l’endurance et l’attente de Dieu ; discerner cela et pouvoir le vivre sont un sujet de joie profonde. »
7e règle : proposer son vouloir dire
Le vouloir dire de ce texte me semble être le suivant. Tous les hommes rencontrent des ennuis, des chagrins, des drames, petits ou grands. Ces faits ont parfois un sens en eux-mêmes, comme ceux révélant les conséquences d’une erreur/faute personnelle. Mais la majorité des maux subis, bien qu’humainement négatifs, sont, en eux-mêmes, moralement neutres. Leur donner du sens[12], par exemple en les appelant « tentation », comme le fait la Bible. C’est déjà une grâce d’y voir, par un acte de conscience, un enjeu potentiel.
Mais dans la difficulté l’homme ne s’arrête pas là. Il peut y trouver une occasion de découragement, de révolte, de mal penser, de mal faire. C’est humain, c’est le subtil début de l’égarement, de la séduction, de l’errance (Ja 1.16 ; 5.19). Voie négative.
Le croyant peut aussi « savoir[13] » que, face à tant d’humains sans espérance, c’est une puissante ressource d’assumer cette difficulté avec Dieu, dans la foi, comme un combat où nous ne sommes pas seuls : premier moment de la voie positive[14]. La difficulté, alors, n’est plus difficulté, ni même tentation, elle devient épreuve (sens strict) : ne pas rester dans la neutralité, résister à la tentation, démasquer la séduction et lui dire non. Entrant dans ce cheminement, le chrétien peut alors faire l’expérience (épreuve) que la foi produit l’attente, le mouvement, la tension vers Dieu, ressort secret mais puissant de la patience-endurance : deuxième temps de la voie ascendante. C’est une seconde grâce, une grâce supérieure venant conforter la première (Jn 1.16). De cela on peut vraiment et sainement se réjouir. Cet enseignement, parfaitement évangélique, me semble essentiel pour l’ensemble de la vie chrétienne.
Philippe AUGENDRE
[1] Héb. nâsah’ , par ex. Es 1.14 ; Ps 55.13.
[2] Héb. "âmad, par ex. Gn 18.22 ; Es 3.13, 21.8.
[3] Héb. miqewèh, par ex. 1 Ch 29.15 ; Jé 14.8.
[4] Grec makrothumia, Rm 2.4 ; 2 Co 6.6 ; Ja 5.10, cf. aussi le verbe makrothumeô, avoir de la patience, de la générosité, ex. Mt 18. 26 ; 1 Co 13. 6 ; Ja 5.7,8.
[5] Les vs. 2 à 12 forment un tout où se font écho : 1. joie et heureux, 2. le couple difficulté-épreuve, 3. l’endurance. Le v. 12 boucle la péricope sur le point d’orgue de la couronne de vie. Au centre : la sagesse et la foi en Dieu testées aux deux « mâshâl » vent-mer du doute, soleil-chaleur du jugement. Le v. 13, quoique très voisin, inaugure un autre sujet, celui de l’auto-séduction testée par la parole et la loi. Ce découpage (v.2-12) est aussi celui de L. SIMON, Une Ethique de la Sagesse, commentaire de l’Epître de Jacques, Genève : Labor et Fides, 1961, p. 9. Un ouvrage remarquable.
[6] Beaucoup de versions font de la pr. n° 3 le C.O., négligeant le fait que celle-ci est une circonstancielle et omettant même le mot « quand » pourtant présent dans le grec.
[7] De très nombreux verbes rendus par des formes conjuguées sont dans l’original des participes présents (Cf. Ap 1. 3-4, p. suivante).
[8] Pluriel de peirasmos, épreuve, tentation, mais aussi difficulté. Le commentaire adventiste (Seventh-Day Adventist Bible Commentary, 2002, v. 2.1, sur Ja 1.2) indique en note : essai, épreuve (test, trial), peine, chagrin, affliction, malheur (trouble) et ajoute : « Le mot peirasmoi comprend beaucoup plus que le mot "tentations" ne suggère... Il comprend les afflictions telles que maladie, persécution, pauvreté et calamité ». Dans l’A.T. (la LXX) et dans les Apocryphes le nom et le verbe (peirazô) veulent dire « épreuve » dans le sens de test, de preuve, mais aussi « tenter » dans le double sens de : a) solliciter au mal, (tentation) et b) essayer, chercher à atteindre (tentative). Cette racine grecque traduit l’hébreu nâçâh (34 versets, 37 mentions). On peut la rendre par mettre à l’épreuve (Gn 22.1 ; Ex 15.25), essayer/oser (Dt 34.4 ; 1 S 17.39 ; Jb 4.2), tenter (Segond), provoquer (NBS, Ex 17.2,7 ; Nb 14.22). L’examen des contextes montre que souvent la signification renvoie à une difficulté, un malheur qui survient. Dans le N.T. (20 v. et 21 m. pour le nom, 33 v et 37 m. pour le verbe), la traduction la plus courante est tenter/tentation/tentateur (Mt 4.1,3 ; 26.41 Ac 5.9 ; 1 Tim 6.9 Ap. 3.10, etc.) Mais le mot est aussi traduit par épreuve/éprouver (Mt 16.1 ; 19.3 ; Mc 8. 11 ; Jn 6.6 ; 8.8 ; Ga 4.14, etc.). Il est parfois rendu par : essayer de/se disposer à (Ac 16.7), examiner (2 Co 13.5). L’emploi de ce mot dans des textes comme Mt 22. 35, Ja 1.12 ; Ap 2.2 3.10 montre que la signification de ces « tentations » est en réalité une souffrance, une difficulté, un malheur.
[9] L. Simon, Op. cit., p. 41.
[10] Le mot (neutre) est rare (ici et dans 1P 1.7). Heureusement les termes de la même famille sont fréquents : dokimê (nom féminin, 6 v. 7 m.), épreuve, preuve, fidélité ou valeur éprouvée, ex. Rm. 5.4 ; 2 Co 8.2 ; 9.13 ; dokimazô (verbe, 21 v. 24 m.), éprouver, approuver, examiner, discerner , juger bon, ex ; Lc 12.56 ; Rm 1.28 ; 1 Co 3.13 ; Ga 6.4 ; 1 P 1.7 ; 1 Jn 4.1, dokimos (adjectif, 7 v. 7 m.), éprouvé (sûr), approuvé, apprécié, qui a fait ses preuves, ex. : Rm 14.18 ; 1 Co 11.19 ; 2 Tim 2.15 ; Ja 1.12. Cette racine a donné le terme de docimologie ou science des examens et de l’évaluation.
[11] 1P 1.6.
[12] L’attribution de sens est un des moteurs puissants de changement, cf. J. LECOMTE et St. VANISTENDAEL, Le bonheur est toujours possible, Paris : Bayard, 2000.
[13] En grec biblique « gignôskô » est beaucoup plus qu’un savoir théorique, c’est une compréhension, une connaissance.
[14] Voir Itinéraires de croissance, GCV/UFB, Vie et Santé, 2004, p. 50.
08:00 Publié dans Jacques | Lien permanent | Commentaires (0)
26/09/2014
Etude n°1 : Jacques le frère du Seigneur, Ja 1.1 ; Actes 15.19-20 ; 21.18-25 (04 10 14)
Etude n°1 : Jacques le frère du Seigneur, Ja 1.1 ; Actes 15.19-20 ; 21.18-25 (04 10 14)
« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande » Jean 15.14
Introduction à l’épître de Jacques.
L’auteur : Il existe trois personnes dans le Nouveau Testament qui 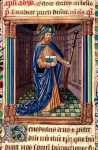 portent ce nom issu de « Jacob », très répandu parmi les Juifs vivant dans un monde grec :
portent ce nom issu de « Jacob », très répandu parmi les Juifs vivant dans un monde grec :
1- Jacques fils de Zébédée, frère de Jean, appelé par Jésus comme apôtre, mort par l’épée dans la persécution ordonnée par Hérode en 44 ap JC (Ac 12.2).
2- Jacques fils d’Alphée, dit le Mineur ou le Petit, pour sa taille ou sa moindre importance parmi les 12 apôtres ? Marc 3.18 ; 15.40. Il ne semble avoir joué aucun rôle important dans l’histoire de l’Église, comme un grand nombre des autres apôtres.
3- Jacques le frère du Seigneur, distingué nettement des apôtres (sauf pour Paul en Gal 1.19), car jusqu’après la crucifixion il ne faisait pas partie des disciples. Il fut surnommé le Juste, même par les Juifs, et mourut après 62, jeté du haut du pinacle du temple et lapidé, sur l’ordre du souverain sacrificateur Ananus (Flavius Josèphe, Ant. XX 9).
Alors que du vivant de Jésus, ses frères et sa mère restaient incrédules, à la résurrection, Jacques eut le privilège d’une apparition spéciale de Jésus, qui le rallia parmi les disciples (Act 1.14 ; 1 Cor 15.7). Il prit une grande place dans l’Église de Jérusalem où il fut considéré comme « une colonne » (Gal 2.9) dirigeante avec Pierre et Jean. Représentant la tendance judéo-chrétienne de l’Église, il fut même craint par Pierre, lors de l’épisode d’Antioche où il envoya des délégués pour vérifier la conduite équivoque des disciples d’origine juive envers les chrétiens d’origine païenne (Gal 2.11-12). Ses prises de décision et sa lettre, montrent un homme soucieux d’une pratique de la foi conforme aux prescriptions de la loi juive, ne mentionnant pas la grâce, mais croyant comme au tout début de l’Église, en Jésus comme le Messie, le Seigneur qui doit revenir, pour lequel on doit redoubler de zèle pour obéir à la volonté de Dieu. Nulle part il ne mentionne un Jésus glorieux, vivant, source d’une vie intérieure nouvelle. C’est pourquoi Luther considérait son épître comme «une lettre de paille » !
L’Épître : Elle fut sans doute écrite d’abord en syriaque, puis transcrite en grec par un secrétaire helléniste, pour les chrétiens juifs de Syrie et des pays voisins, au moment de la dispersion des disciples après le meurtre d’Étienne (Act 8.1) ou un peu plus tard en 44 à la persécution d’Hérode (Act 12.2). En effet les problèmes des relations avec les païens n’étaient pas encore apparus, la lettre n’y fait aucune allusion, pas plus qu’à Paul, qu’il rencontrera plus tard au concile de Jérusalem (en 48-49, Act 15).
La lettre s’adresse à des Judéo-chrétiens, appelés « tribus dispersées» (1.1) qui ont été persécutés pour leur foi, qu’il cherche à fortifier, et à qui il demande de pratiquer une discipline de vie pleine d’amour (1.26-27), par laquelle ils prouveront leur foi dans le Seigneur (2.14-26). Pas d’exposé doctrinal, pas de mention de la vie et de l’œuvre de Jésus-Christ ni du Saint-Esprit, mais des citations ou des allusions aux prophètes et personnages de l’Ancien Testament (Job, Elie). Jacques reste très attaché à son origine juive !
Le plan de la lettre n’est pas très rigoureux, Jacques abordant des questions de conduite de vie et des exhortations, sans enchaînement rigoureux.
Pour mieux cerner la personnalité de Jacques, frère de Jésus, nous étudierons outre le premier verset de la lettre, deux textes des Actes des apôtres, plus tardifs que la lettre, où il est intervenu avec autorité, au concile de Jérusalem (Act 15) et à la dernière venue de Paul à Jérusalem (Actes 21).
Observons Actes 15.13-21
V 13-14 : Qui prend la parole après les exposés de Pierre, Paul et Barnabas ? Comment appelle-t-il Pierre ? Qu’est-ce que cela signifie sur sa forme de pensée ? A quel événement fait-il allusion ?
V 15-18 : Pourquoi fait-il référence aux prophètes Amos (9.11-12) et Esaïe (54.1-5) ? Que reconnaît-il par là au sujet de la volonté de Dieu ? Quelle pensée cela peut-il suggérer en lui ?
V 19 : Comment se marque l’autorité de Jacques ? Par quoi le récit de Luc adoucit-il cette prise de décision ( voir v 22 et 28).
V 20 : Comment ces prescriptions dites « noachiques » (venant de Noé) sont-elles un moyen de faire des païens « un peuple consacré à Dieu » (v 14) ? Pourquoi sont-elles jugées indispensables ? ?
V 21 : Comment ce verset révèle-t-il l’objectif poursuivi par Jacques dans ces prescriptions ?
- Que peut signifier le silence sur la question de la circoncision qui avait provoqué la réunion de Jérusalem (v 5 et 7-11) ?
Observons Actes 21.18-26
V 18 : Chez qui se rendent Paul et ses compagnons ? Comparer la formulation de Luc dans Actes 15.4,14,22.
V 19 : Que présente Paul à l’assemblée ? voir Rom 15.18-19.
V 20 : après de brèves félicitations, quelle préoccupation prend le dessus chez les anciens de Jérusalem ?
V 21 : De quelle rumeur font-ils état (v 28) ? Quel est le point central de l’incompréhension et de l’hostilité des Juifs ?
V 22 : Quelle crainte habite les anciens ?
V 23-24 : Quelle proposition font-ils pour résoudre à leurs yeux le problème ?
V 24-25 : Qu’est-ce qui prouve que Jacques est derrière cette proposition ?
V 26 : Pourquoi Paul accepte-t-il ce compromis qui se révèle vite inutile (v 27) ?
- Quelles différences y a-t-il entre les deux assemblées ? A qui se sont-elles référées pour prendre des décisions ? Avec quels résultats pour l’Église et les individus ?
Comprenons
Parmi les fils de Joseph et Marie, Jacques est cité en premier, toujours accompagné de leur mère Marie (Mt 13.55 ; Mc 6.3). Il entre tardivement dans l’histoire de l’Église, car incroyant jusqu’à la résurrection, il s’efforçait avec toute sa famille de ramener Jésus à la raison en redevenant anonyme (Mc 3.21 ; 3.35 ; Jn 2.12), ou il l’incitait à se manifester avec puissance pour être vu et suivi par tous (Jn 7.3-5). Jacques n’est pas présent à la croix, mais il réapparaît après qu’il a eu la révélation spéciale du Christ ressuscité (1 Cor 15.7). Il se tient en effet avec sa famille dans la chambre haute pour attendre l’effusion de l’Esprit (Ac 1.14 ; 2.1). Toutefois, aux premiers temps de l’Église, l’autorité est confiée à Pierre et à Jean. La persécution et les voyages de Pierre hors de Jérusalem finissent par donner à Jacques, la première place dans la communauté de Jérusalem. A cause de son lien de sang avec Jésus ( ?), ou de son attachement à la pratique juive de la nouvelle foi ( ?), il devint une des trois « colonnes » de l’Église avec Pierre et Jean (Ac 12.12 ; Gal 2.9). Il fut respecté et même craint dans les églises de Syrie, comme le montre l’épisode mentionné par Paul (Gal 2.11-12) où Pierre eut à Antioche une attitude équivoque vis-à-vis des chrétiens d’origine païenne , devant les envoyés de Jérusalem.
C’est Jacques qui suggéra les prescriptions du concile de Jérusalem, approuvées par les anciens, l’Église et le St Esprit (Act 15), mais c’est aussi sans doute lui qui, sans consulter le St Esprit, donna à Paul venu à Jérusalem, le conseil de ménager les Juifs traditionnels en aidant certains disciples à s’acquitter de leur vœu de naziréat, comme le suggère le rappel inexpliqué des prescriptions pour les pagano-chrétiens, à la fin des recommandations faites à Paul (Ac 21.25).
La prédication chrétienne parmi les Juifs se contentait dans ses débuts à affirmer la Messianité de Jésus (voir les discours de Pierre et Jean : Act 2.32-35 ; 3.18-26 ; et celui d’Étienne : Act 7.52 ) et sa seconde venue pour juger chacun (Ja 2.12-13 ; 5.7-9). D’où l’abondance des recommandations de Jacques pour une foi manifestée par une vie obéissante à la volonté de Dieu.
La lettre est écrite à des Judéo-chrétiens appelés « les 12 tribus dispersées », Juifs convertis, ayant fui la persécution de Jérusalem dans des contrées avoisinantes, dont les plus riches sont négociants (4.13) ou agriculteurs (5.4,7). Jacques ne fait aucune allusion à des chrétiens d’origine païenne, ce qui laisse à penser que la lettre fut écrite avant le concile de Jérusalem tenu en 48-49.
On peut remarquer la discrétion de Jacques sur son lien de sang avec Jésus. Modestie, humilité, ou culpabilité à cause de son attitude envers lui de son vivant sur terre ? Il ne veut pas que ce lien naturel avec le Seigneur lui confère plus d’importance et de respect aux yeux des autres judéo-chrétiens. Il a retenu la leçon de Jésus (Marc 3.34-35) : « La mère et les frères de Jésus ou ses amis (Jn 15.14) sont ceux qui font sa volonté ». Les liens du sang ne donnent aucun privilège ! Jacques s’attache alors à préciser comment vivre selon la volonté de Dieu, révélée dans ses commandements (Dt 20). Outre sa lettre, les deux autres récits postérieurs ( Act 15 en 48 et Act 21 en 58) révèlent la préoccupation permanente du chef de l’Église : ne pas choquer ses frères Juifs, qu’ils soient devenus chrétiens ou non, par une conduite idolâtre qui enfreindrait les commandements de Dieu. Il n’a pas de préoccupation dogmatique, par exemple à propos de la circoncision que les Judéo-chrétiens voulaient imposer comme moyen de salut. Ses recommandations concernent la vie pratique à cause du témoignage de foi qu’elle porte, et non comme moyen de salut. S’il prescrit aux païens qui se convertissent, d’éviter les pratiques idolâtres grecques (manger des viandes sacrifiées aux idoles, ingérer le sang des animaux étouffés et s’adonner à la prostitution sacrée) qui étaient censées donner aux fidèles la force et la fertilité du dieu adoré, c’est dans un souci de vie pratique dans les communautés : ces païens ne doivent pas choquer les fidèles Juifs, répandus dans toutes les villes gréco-romaines par des habitudes de vie contraires à la foi en l’Éternel. La circoncision n’étant pas mentionnée devient secondaire, et par ce silence Jacques fait comprendre aux Juifs qu’elle ne concerne pas le salut ni même le « vivre ensemble » de la communauté chrétienne.
En mentionnant l’inspiration du St Esprit et l’approbation de toute la communauté, Luc, l’auteur du livre des Actes, fait de cette décision de Jacques (15.19), une volonté divine pour le bien de son Église. Mais en Actes 21, à aucun moment l’Esprit n’est invoqué pour recommander à Paul de paraître un « bon observateur de la loi » en aidant quatre frères à remplir leur vœu de naziréat, alors que dans les chapitres précédents, Paul agit toujours sous l’impulsion de l’Esprit (Act 20.22-23,28 ; 21, 9-14). Par peur des Juifs « zélés pour la loi » (21.20,22) Jacques et les anciens veulent préserver les apparences et propose à Paul un compromis, que celui-ci accepte, par gain de paix sans doute, par humilité devant les "colonnes" de l’Église de Jérusalem, ou parce qu’il pense que cela ne concerne que lui. Mais la suite nous montre que ce compromis fut vain et précipita même l’arrestation de Paul par les Juifs. Le souci légaliste de Jacques et de l’église de Jérusalem ne semble donc pas avoir reçu l’approbation de l’Esprit. Il rejoignait sans doute trop le légalisme pharisien et intransigeant des non convertis qui persécutèrent l’Église. Paul en acceptant ce compromis mettait dans l’ombre ce pour quoi il avait travaillé jusqu’alors au service de Dieu : la liberté de l’Esprit et la grâce en Jésus-Christ, dont Jacques ne parle pas dans son épître. (C’est pourquoi Luther la méprisait et la considérait comme une « lettre de paille » !). Pourtant en tenant compte des circonstances de cette lettre, on ne peut mettre en doute la foi de Jacques en Jésus ; sa préoccupation de la mise en œuvre pratique de cette foi est précieuse pour tous les chrétiens, car elle vient en complément des développements théologiques et doctrinaux de Paul.
Questions pour une application dans la vie chrétienne
- Quel lien y a-t-il entre ma foi et mes origines familiales ? Suis-je « chrétien parce que je suis né dans une famille croyante ? parce que je garde ses traditions ? parce que j’ai rencontré personnellement le Christ ?Appartenir à une famille ou une communauté chrétienne est-ce une garantie de mon salut ?
- En quoi consiste ma vie de foi ? une observation scrupuleuse des préceptes bibliques et ecclésiaux ? une habitude de culte hebdomadaire ? un service de Dieu auprès de mes frères en la foi ou auprès de mon entourage ? une vie de prière régulière ? une relation vivante et joyeuse avec mon Sauveur, nourrie par sa Parole enseignée à l’église et étudiée en particulier ?
- Comment puis-je mettre en pratique pour glorifier Dieu toutes les connaissances bibliques que j’ai acquises ?
- Quelles habitudes, ou pensées contraires à la volonté de salut de Dieu continué-je à cultiver ? Comment les abandonner ?
08:04 Publié dans Jacques | Lien permanent | Commentaires (0)