04/01/2013
Etude n°2 : Création du monde, Genèse 1.1-13 (12 01 13)
(Illustration de Zabou : Création par la Parole)
« Ainsi parle l’Éternel qui a créé les cieux, lui le seul Dieu, qui a façonné la terre ; il l’a formée, c’est lui qui l’affermit. Il ne l’a pas créée vide, il l’a façonnée pour qu’elle soit habitée. Je suis l’Éternel, et il n’y en a pas d’autre. » Es 45.18

Introduction
Pour étudier ce texte poétique, nous avons privilégié une étude globale pour faire ressortir l’enseignement spirituel (= concernant la relation avec Dieu) qu’il contient.
Ce premier récit de la Création est une véritable œuvre d’art, construit très harmonieusement. Il a une portée avant tout pédagogique. En aucun cas il ne se veut scientifique ou même historique, expliquant le « comment » des choses. Il est, en effet, organisé pour faire saisir le « pourquoi » des choses que l’homme peut voir dans son environnement.
Observons
Remarquez comment le texte est construit :
Un premier verset qui est un résumé de ce qui est détaillé ensuite, selon la coutume des récits bibliques, un dernier verset (2.4a) que l’on peut considérer soit comme la conclusion du premier récit de la Création, soit comme l’introduction du second récit.
Entre ces deux versets, le texte se découpe selon les jours de la semaine rythmés par les refrains : Il y eut un soir et un matin... et les répétitions : Dieu dit = 10 fois, Dieu appela = 5 fois, Il en fut ainsi = 5 fois, créer, Dieu vit que cela était (très) bon = 7 fois ; Dieu bénit = 3 fois, si l’on joint les versets 2. 1-3 au chapitre 1.
On constate en outre que les trois premiers jours sont consacrés aux espaces habitables, les trois jours suivants, à leurs habitants. Dans l’énumération suivante, il est intéressant de remarquer qu’à chaque espace correspond une catégorie d’habitants : les points 1 et 4, 2 et 5, 3 et 6, se correspondent :
Espaces habitables :
1- Lumière (séparation d’avec les ténèbres)
2- Ciel et mer (séparation des eaux d’en-haut = air, des eaux d’en-bas = mer)
3- Terres sèches (séparation d’avec les eaux marines) et végétation
Habitants :
4- Points lumineux (soleil, lune, astres)
5- Oiseaux et créatures aquatiques
6- Monde animal (bétail, reptiles, animaux sauvages, et humains)
Comprenons
Par le récit de la Création, tel que Dieu l'a rappelé à Moïse, Dieu a voulu rétablir la vérité sur Lui, sur l’homme, sur l’univers. Il a voulu montrer que la Création ne pouvait être l’œuvre que de quelqu’un d’intelligent, de sage, qui savait ce qu’il entreprenait, et avait un but précis : l’épanouissement de la vie et de l’homme sur la terre.
Nous allons voir comment ce message est transmis dans le texte de Genèse 1 :
-
Enseignements sur Dieu
a) Les répétitions du verbe « dire » insistent sur la Parole et ses effets. Pour Dieu, parler est une véritable action qui permet la venue à l’existence de toute chose ( En hébreu, parole et acte sont un seul et même mot). Voir les deux textes complémentaires de Ps 33.9 et Jn 1.1-3.
L’homme n’a pas cette capacité de créer la matière et la vie rien que par la parole. Si la parole humaine a beaucoup de puissance bénéfique ou maléfique : compliment qui fait plaisir, encouragement qui redonne le moral, ou injure qui blesse, discours qui trompe et donne de faux espoirs, etc, elle n’a d’effets que sur l’esprit des gens, mais par sur la matière, car l’homme ne peut pas créer, il peut seulement transformer la matière en la manipulant.
Dieu se montre ainsi bien supérieur à l’homme !
Les mots « créer » et « Dieu vit que cela était (très) bon » se retrouvent 7 fois. C’est sur ce chiffre qu’est fondée la semaine donnée à l’homme comme repère de temps. Dieu veut signifier par là que ce qu’il a conçu, puis créé, était parfait, et correspondait à ses intentions de bonheur pour l’homme sur la terre. Ce chiffre est un peu comme la marque de qualité que Dieu appose sur son œuvre.
Premier enseignement du récit : Dieu crée tout parfaitement par sa Parole
b) Un problème chronologique et logique, selon notre expérience des phénomènes de photosynthèse, est posé par l’ordre des créations : la lumière et la végétation apparaissent le 1er et le 3ème jour, avant les astres (4ème jour) qui indiquent les saisons, les jours et les nuits. Mais le texte n’est pas un rapport scientifique, il veut apprendre quelque chose sur Dieu : Il est la lumière nécessaire à toute vie (Jn 1.4)!
Le verset 2 commence le récit par un tableau de ce qui existait au moment où Dieu organisa la terre pour la vie de l’homme. Ce verset permet de penser qu’il y eut un laps de temps indéterminé entre la création de la matière et son organisation pour la vie.
Le texte indique aussi qu’il y avait des ténèbres. D’où venaient-elles ? C’est comme si l’auteur voulait nous dire qu’elles ne venaient pas de Dieu, comme le mot « ténèbres » employé par Jean dans son prologue de l’Evangile le laisse entendre, mais que l’Esprit de Dieu les maîtrisait. C’est un indice précieux de l’existence du Mal antérieure à la création de notre monde, qu’on peut rapprocher des textes d’Esaïe 14.12-15, Ezéchiel 28.14-19, et Apocalypse 12.7-9, pour tenter de comprendre la rébellion de Satan contre Dieu.
Que la lumière soit ! (v 3): en opposition aux ténèbres, le texte révèle que là où Dieu se manifeste, jaillit la lumière. Si on veut travailler dans un endroit, il faut de la lumière, pour distinguer les objets. La lumière donne la possibilité de prendre conscience des choses. Ainsi nous pouvons comprendre comment sur le plan psychologique et spirituel, Dieu dans sa Parole est lumière pour nous : Il nous permet de prendre conscience de notre état devant Lui, et nous révèle les moyens de rester en communication avec Lui. Le récit ne donne là aucun renseignement scientifique, mais il se place au niveau spirituel.
c) Le processus de création suivi par Dieu est celui d’une œuvre d’art : il y a d’abord création du cadre avec les éléments essentiels à la vie : lumière, air, eau, terre, végétation. L’air est indiqué dans la Bible comme "l’étendue". Les Anciens considéraient que cette étendue, ou atmosphère, était la frontière entre les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont au-dessous, c’est-à-dire celles de la terre. Ils expliquaient ainsi la présence de l’eau de pluie, de la brume et des nuages dans l’atmosphère : c’étaient les eaux du dessus qui passaient par les trous de l’étendue !
Après le cadre, il y a création du contenu, les trois jours suivants : les astres, les animaux et l’homme. Nous verrons ce contenu la semaine prochaine.
En ordonnant ainsi le récit, Dieu indique qu’il agit selon un projet précis, voulu, conçu dans sa pensée et exécuté méthodiquement. À comparer avec la démarche de l’architecte, ou celle de l’artiste. Tout a été prévu par Dieu pour que la vie soit possible sur terre. Remarquons que tout est dit deux fois, d’abord quand Dieu exprime son intention, puis quand il la réalise par sa Parole.
Second enseignement : Dieu a tout conçu et réalisé selon un plan précis.
Le récit biblique de la Création nous donne un troisième enseignement : Dieu veut, dans tout l’Ancien Testament, se révéler comme le seul vrai Dieu. Chacun des jours de la Création frappe de plein fouet toutes les idolâtries de l’Antiquité, mais aussi de notre époque avec les philosophies et religions panthéistes, qui adorent la Nature et ses forces, comme l’avaient fait les Egyptiens, dont les Hébreux devaient s’affranchir !
Voici la liste des dieux de l’Egypte, qui étaient présents à l’esprit des Hébreux au moment de l’Exode, pendant lequel Moïse eut la révélation des récits de la Genèse :
1- Nout = la voûte céleste avec astres ;
2- Râ = dieu-soleil avec cobra-énergie sur une tête de faucon ;
3- Apis = dieu-taureau de la fertilité, de la vie.
4- Sekhmet = déesse-lionne de la guerre ;
5- Khnoum = dieu-bélier de la crue du Nil ou de la fécondité ;
6- Thot = dieu de la sagesse à tête d’ibis ou de babouin ;
7- Seth ou Anubis = dieu-chacal du mal et de la mort ;
Le récit très structuré n’est pas scientifique. Ce n’est pas un rapport qui rend compte objectivement des faits observés. De toute façon, l’auteur du livre, n’était pas présent au moment de la Création ! Dans la façon dont il relate cet événement miraculeux, il témoigne de sa foi en un Dieu Roi de l’Univers :
a) Dieu existe à l’origine de tout. Aucune description n’est fournie sur l’apparence de Dieu. Il existe tout simplement.
b) C’est Lui qui a tout fait. Il est à la fois l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur, l’artiste, le charpentier, le jardinier, l’électricien, etc.
c) Il crée par sa seule Parole : Il ne fabrique pas à partir d’une matière préexistante, il fait jaillir la matière et les êtres vivants de la formulation de sa pensée, à la différence de l’homme qui ne peut que transformer la matière.
d) Dieu est le seul dieu. Il est au-dessus de toutes ses créatures et des corps célestes, qu’il dirige selon son plan. Ce texte réfute l’adoration païenne de la Nature et le polythéisme des religions environnantes. Si Dieu est unique, il se manifeste de façon « plurielle », selon ses fonctions.
e) Dieu est un Dieu d’ordre. Tout était à sa place et occupait la fonction pour laquelle Dieu l’avait créé.
f) Dieu a tout créé bon. Il est parfait et son œuvre reflétait cette perfection.
Questions pour une mise en pratique dans la vie chrétienne :
a) Dieu procéda à la création du monde selon un plan bien conçu et méthodique : Qu’en est-il de nous? Agissons-nous toujours conformément à nos intentions ? Et ensuite, nous donnons-nous la peine de vérifier si notre travail est bien fait?
b) Savons-nous réfléchir et organiser notre action avant de nous lancer dans l’action, ou agissons-nous selon nos impulsions ? Quels en sont les résultats ?
c) Quelle valeur accordons-nous à la parole prononcée, aux promesses données ? Dans quelles circonstances avons-nous pu en évaluer la puissance, et en voir les effets bénéfiques ou au contraire néfastes ? Comment participer à l’œuvre créatrice de Dieu par la parole ?
d) Plutôt que de discuter sur la littéralité ou l'historicité du récit de la création, que puis-je en retirer spirituellement pour vivre mon quotidien ?
08:00 Publié dans Origines | Lien permanent | Commentaires (1)
28/12/2012
Etude n°1 : Jésus Créateur des cieux et de la terre Col 1.15-20 (05 01 13)
"Au commencement Dieu créa le ciel et la terre " Gen 1.1
Observons Colossiens 1.15-20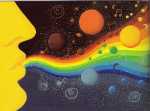
Le contexte (1.1-11)
(Zabou : La Parole créatrice de l’Univers)
Paul rend grâces à Dieu pour la foi et la charité des chrétiens de Colosses, église de Phrygie en Asie Mineure, fondée et dirigée par Epaphras (v 7). Il prie pour qu’ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, « en toute sagesse et intelligence spirituelle» (v 9), et qu’ils marchent d’une manière digne du Seigneur (v 10-11). Aux versets 12-14, Paul énumère les sujets d’action de grâces des croyants : la participation à l’héritage des saints dans la lumière, la délivrance des ténèbres, l’entrée dans le royaume du Fils, la rédemption, le pardon des péchés en Christ.
Le texte (v 15-20) : Qualités du Christ,
V15-16 : image du Dieu invisible et Créateur
V 17-18 : Origine et protecteur de tout, premier en tout, chef de l’Eglise
V : 19-20 : Réconciliateur
La suite du texte (v 21-23) démontre les effets de l’œuvre de Christ dans la vie des croyants : Réconciliation et justification en Christ (v 22) ont pour fruit la persévérance dans la foi et l’espérance.
Comprenons
Notre texte de Colossiens place les deux mots de « rédemption » (apolutrõsis) et de « rémission » (aphesis) des péchés (v 14) au cœur de l’action de grâce du croyant en Jésus-Christ, et prend soin de décliner les qualités du Christ qui font de lui le seul Sauveur de l’Univers et de l’Eglise, pour ensuite énoncer les fruits de la rédemption.
Examinons les qualifications de Christ pour accomplir son œuvre de rédemption
V 15 : Jésus est l’image du Dieu invisible : il est le seul qui rende perceptible à l’homme la divinité invisible, spirituelle (Jn 1.18). Il est la vraie manifestation de l’amour de Dieu (Jn 8.19 ; 14.9), car lui seul est descendu du ciel pour le révéler (Jn 3.13).
V 16-17 : Le premier-né de la création : contrairement à certains interprètes, il ne faut pas prendre cette expression littéralement dans son sens biologique, ce qui ferait du Christ une créature. Le « premier-né » était un titre qui marquait la fonction éminente, la dignité suprême, ou l’origine d’un événement.
Les versets 16-17, introduits par la coordination « car » expliquent et précisent cette expression. « Tout, (visible et invisible) a été créé en lui, par lui, et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui». Sa préexistence de Concepteur (« en lui »), de Créateur (« par lui ») et de destinataire (« pour lui ») le rend supérieur et d’une autre essence que toutes les créatures angéliques (Hé 1), humaines, animales, ou végétales, que l’homme aurait tendance à adorer comme intermédiaires entre la Divinité et lui (2.18). Cette puissance créatrice qui n’appartient qu’à Lui, le rend à même de conserver l’univers, de soutenir son existence (v 17), car sans Lui, l’univers, livré à lui-même, irait à sa destruction. L’exemple de Pharaon, livré à son endurcissement de cœur qui le conduit à la mort (Exode 11 et 14.7-18, 28) est là pour nous faire comprendre que lorsque l’Esprit qui soutient toute chose est obstinément refusé, Il ne peut plus agir et se retire en laissant le monde livré à ses propres choix destructeurs. Mais heureusement, Dieu par amour « use de patience, car il ne veut pas qu’aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance » (2 Pi 3.9).
V 18 : Après l’exposé du rapport de Christ à Dieu le Père, et de son rapport à l’Univers, Paul aborde son rapport à l’Eglise : Il en est la tête, le chef, ce que les faux docteurs de Colosses semblent avoir contesté (2.18). L’Eglise, corps du Christ est une image chère à Paul (1 Co 10.17 ; 12.12 ; Eph 1.22-23,…) pour exprimer l’union de Christ avec les croyants qu’Il dirige et anime, et leur solidarité dans la diversité des membres qui la composent. La tête est vitale pour un corps. C’est d’elle que viennent les impulsions mentales qui le font se mouvoir, et la conscience de ce qu’il est et fait. Ainsi l’Église sans le Christ n’est qu’un groupe de cellules sans conscience ni direction, donc sans vie et anarchique. Comme c’est la tête aussi qui donne leur unité d’action aux différents membres du corps, c’est Christ qui unit les membres de l’Église au-delà de leurs différences sociales, culturelles, raciales et religieuses. L’Eglise est ici considérée comme une seconde création, spirituelle, dont Jésus est l’origine, le commencement, comme il l’a été de la création physique. Grâce à la résurrection de Christ, l’humanité peut commencer une nouvelle vie dont Christ est la source. Comme « premier-né d’entre les morts » (v 18), « prémices de ceux qui sont décédés » (1 Co 15.20), il ouvre le chemin de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui et ainsi constituent l’Église.
V19 : « Dieu a fait habiter en lui toute la plénitude » (voir 2.9 ; Eph 1.23). Le mot plénitude (plèrôma) est traduit en Ephésiens 4.13, par « perfection », « stature parfaite ». Il donne l’idée qu’il n’y a rien de mieux, qu’on ne peut dépasser, et que toute la personne de Dieu l’habite sans obstacle ni manque. Paul insiste sur l’identité divine du Christ comme Jésus l’avait fait comprendre en affirmant que « Le Père et moi, nous sommes un, je suis dans le Père et le Père est en moi » (Jean14.10-11 ; 17.21-22).
V 20 : Image visible du Père, créateur de tout l’univers, rempli de la plénitude de son Esprit, Christ est le seul à pouvoir « réconcilier» avec Lui sa création séparée de Lui par un choix d’autonomie funeste (Gen 3). Puisque Christ est prééminent en tout, origine de tout, puisqu’il est ressuscité et a retrouvé la plénitude de sa nature divine, il a la puissance de vie et les qualifications pour accomplir parfaitement l’œuvre du salut dont la première étape, la réconciliation avec Dieu de tout l’univers, s’est réalisée par son sacrifice sur la croix : il a fait le don de sa vie pour offrir le pardon et la vie nouvelle à celui qui croirait en Lui (Jean 3.16). Libéré par Christ du poids de son péché, le croyant peut maintenant s’approcher de Dieu, son Père, le cœur en paix (Héb 4.16 ; 7.25 ; 10.22).
Telle est la magnifique profession de foi de Paul aux Colossiens, dont il va décliner les effets concrets sur la vie du croyant, dans le passage suivant.
Questions pour une application dans la vie chrétienne
-
Qu’est-ce que sa qualité de Créateur ajoute à ma foi en Jésus ? Qu’est-ce que cela change à ma relation avec lui ?
-
Comment puis-je, comme chrétien réconcilié avec Dieu par Christ, vivre en paix avec moi-même et avec les autres ? Quelles réconciliations ai-je encore à faire ?
-
Si Christ est le « premier-né d’entre les morts », comment montrer que je l’ai suivi en « ressuscitant » moi-même ?
-
Comment participer concrètement, personnellement ou en Église, à cette œuvre de réconciliation avec Dieu et de recréation de l’Univers, au niveau de notre environnement et de nos relations ?
08:00 Publié dans Origines | Lien permanent | Commentaires (0)















