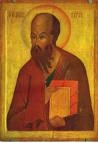30/05/2014
Étude n°10 : Christ, la loi et l’alliance, Héb 10. 11-18 (07 06 14)
« Il est médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l’héritage éternel. » Héb 9.15
Observons Héb 10.11-18

Le contexte
L’auteur de l’écrit aux Hébreux a démontré que la loi, c’est-à-dire les prescriptions rituelles de l’ancienne alliance, possédait seulement « l’ombre des réalités spirituelles » que Christ a accomplies parfaitement dans le sacrifice de soi, volontaire et unique, pour le pardon des péchés et la sanctification des croyants (Héb 10. 1-10).
Le texte : en trois paragraphes :
a) v 11-14 : le sacrifice unique de Christ affranchit du péché et sanctifie le croyant.
b) v 15-17 : dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit témoigne de la rémission des péchés.
c) V 18 : l’expiation accomplie par Jésus supprime les sacrifices pour le péché.
- Relever les notions de temps, les répétitions, et les oppositions dans le premier paragraphe (11-14). Qu’est-ce que ces oppositions mettent en valeur sur le rôle de Christ ?
- Que signifie « être assis à la droite de Dieu » ? « rendre parfaits à perpétuité » ?
V 15-17 : Comment est introduite la citation des Écritures ? Quel est le rôle du Saint-Esprit ? Comparer avec Jean 14.26 et 16.13.
- v 18 : Quelle est la principale caractéristique de la Nouvelle Alliance ?
Comprenons
Ce passage termine le discours doctrinal visant à confondre l’erreur des lecteurs chrétiens hébreux, qui regrettaient les institutions mosaïques, et par là contestaient la valeur expiatoire (= la puissance de pardon) de la mort de Jésus. L’auteur a cherché à montrer la supériorité de Christ sur les rites de l’ancienne alliance, et principalement sur le rite annuel du Yom Kippour (10.1,3) qui préfigurait le sacrifice unique de Christ pour « ôter les péchés », et la justification finale du peuple de Dieu. La loi (= ici la loi rituelle annuelle, v 1,8) n’était qu’une « parabole » prophétique de l’œuvre de Christ. Elle ne pouvait en aucun cas « sauver » le pécheur, ni le sanctifier, c’est-à-dire le rendre apte au service de Dieu. L’auteur entend par le mot « Loi » le système rituel de l’ancienne alliance et en particulier celui du Jour des Expiations (9.7), qui suggéraient, comme une « ombre » ou une silhouette un peu floue, les « biens à venir », c’est-à-dire ce que Jésus accomplirait : l’expiation des péchés, le pardon, la sanctification et le perfectionnement du croyant. On ne pouvait que deviner de façon floue comment s’accomplirait cette rédemption. L’Évangile au contraire en retraçant la vie et la mort du Rédempteur offre une représentation exacte de ces réalités spirituelles sur lesquelles repose notre salut. Il nous permet de les connaître entièrement et d’en éprouver les effets.
L’auteur revient sans cesse sur le Jour des Expiations parce que le sacrifice de ce jour exprimait le mieux l’idée symbolisée par tous les autres, le sacrifice expiatoire de Christ sur la croix pour la rémission des péchés du monde. Pour saisir la valeur expiatoire du sacrifice de Jésus, il faut se rappeler le sens symbolique du rite du Jour des Expiations (Lév 16). Le grand sacrificateur répandait ce jour-là le sang pur du bouc expiatoire sacrifié à l’Éternel sans imposition des mains, sur le propitiatoire qui couvrait l’arche (Lv 16.15). Ainsi il « faisait l’expiation pour le sanctuaire à cause de l’impureté des Israélites ». Faire l’expiation a deux sens simultanés : protéger le pécheur de la condamnation qu’il encourt à cause de son péché, et éliminer le mal. Christ a offert sa vie (= son sang) pour protéger le pécheur de la mort qu’il mérite, et pour éliminer son péché (Lv 16.30 ; Hb 10.14), le « rendre parfait » c’est-à-dire le rendre achevé, le faire parvenir au but qui est la communion éternelle avec Dieu sans obstacle, dans la sainteté, l’amour et la joie.
Jésus-Christ est présenté ici à la fois comme le grand sacrificateur, et comme la victime offerte, à cette différence avec les victimes des sacrifices de l’ancienne alliance, qu’il s’offre volontairement lui-même, portant consciemment le péché de l’humanité séparée de Dieu, afin de le mettre à mort dans son corps crucifié, comme le symbolisaient les victimes de l’ancienne alliance. Cette offrande de lui-même est unique (v 12, 14), et suffisante pour apporter le pardon à ceux qui se l’approprient (Rom 6.4). Pardonnés (v 17) et considérés par Dieu comme justes, « parfaits »(v 14) malgré leur nature toujours pécheresse, les croyants de la nouvelle alliance sont mis à part (= sanctifiés) pour le service de Dieu, grâce au Saint Esprit qui « écrit la loi dans leur cœur et leur intelligence ». L’Esprit Saint qu’ils accueillent, transforme leur être intérieur (= le cœur), leur vision spirituelle (= intelligence), de sorte qu’ils suivent la volonté de Dieu avec reconnaissance, et dans une nouvelle perception de ses préceptes (Voir le discours de Jésus sur la Montagne, Mat 5-7). Assurés du pardon de Dieu en Jésus-Christ ils n’ont plus besoin de recourir aux rites de l’Ancienne Alliance (v 18).
Ils savent aussi que Christ a retrouvé pleinement sa nature divine dans la gloire de Dieu. Il participe à son gouvernement du monde, jusqu’à ce que ses ennemis lui soient définitivement soumis (v 12-13). Leur foi dans l’œuvre et l’action de Christ en leur faveur les rend pleins d’assurance dans cette attente (v 19-22) que le Saint-Esprit remplit d’espérance et de reconnaissance.
Questions pour une application dans la vie chrétienne
- Que représente pour moi le sacrifice de Christ ? Essayer de l’exprimer avec simplicité et sincérité, sans recourir à des mots « théologiques ».
- Quel lien faisons-nous entre obéissance à la loi et pardon ? Comment notre comportement religieux le révèle-t-il ?
- A quoi m’engage l’assurance du pardon de Dieu ? Si je n’ai pas cette assurance, pourquoi ? et comment y parvenir ?
- Qu’est-ce qui subsiste des pratiques et des conceptions de l’ancienne alliance, dans notre foi chrétienne, à propos de la place de la loi par exemple?
08:00 Publié dans Christ et Loi | Lien permanent | Commentaires (1)
23/05/2014
Etude n°9 : Christ, loi et évangile Mat 7.21-27 (31 05 14)
« La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ » (Jean 1.17)
Observons
Le contexte :
12 : Règle d’or du disciple
13-14 : porte étroite du royaume
15-20 reconnaître les faux prophètes à leurs fruits
Le texte 21-27 contient deux paragraphes :
L’enseignement (21-23) : Sur quel mot du verset précédent se fait l’enchaînement des idées ?
A quelle scène assistons-nous ? (21-23)
Qu’est-ce qui est opposé dans les deux versets 21 et 22 ? (voir les répétitions)
Qu’est-ce que Jésus qualifie de « connaître » et « d’iniquité » ? (v 23)
De quelle nécessité parle-t-il ?
La parabole illustrative (v 24-27) : Les deux maisons :
En quoi consiste la prudence du premier bâtisseur ? Que peut représenter le « roc » (24-25) ?
Qu’est-ce qui caractérise l’insensé ? En quoi le Ps 53.2 peut-il s’appliquer ici ?
Que représentent le sable et la ruine ?
Comprenons
Le sermon sur la montagne rassemble les enseignements de Jésus sur les lois de son Royaume. Jésus le termine en les résumant au verset 12, dans la loi d’amour du prochain comme soi-même, puis en mettant en garde les croyants au sujet des faux enseignements qui ne seront décelables qu’aux fruits qu’ils portent (v 20).
L’enseignement de Jésus :
Notre texte conclut le sermon sur la montagne sur un avertissement : les conséquences de la mise en pratique ou non de ses paroles sont éternelles.
Par là même, Jésus se pose en juge divin, puisqu’il fait référence au jugement final, dans les termes consacrés des prophètes « en ce jour-là, alors » et en opposant les temps des verbes : passé pour les actes humains, futur pour le jugement rendu par lui.
Jésus développe l’image des fruits en indiquant ceux qu’il considère comme « bon » ou « mauvais ». Les fruits par lesquels on pourra reconnaître les faux prophètes ou faux croyants, sont non seulement les conséquences de leurs fausses doctrines dans l’Église (dissensions, désobéissance à la loi divine), mais aussi l’incohérence de leurs actes avec ce qu’ils veulent paraître.
Répéter le nom du Seigneur (dans la version grecque c’était la traduction de l’hébreu Yahvé, l’Éternel) pour paraître très pieux, ou même accomplir des miracles spectaculaires au nom de Jésus (répété 3 fois), restent des signes extérieurs de piété, mais n’implique pas une adhésion du cœur à la volonté d’amour de Dieu.
Paul le dira magistralement aux Corinthiens (1 Cor 13).
La recherche de ces hommes n’est pas la communion intime avec le Seigneur, mais la propre gloire égoïste, ou l’accumulation de mérites pour le Royaume. C’est ce que Jésus appelle l’iniquité, le mal, qu’il oppose à l’obéissance à ses paroles d’amour.
La poursuite du superficiel est à l’opposé de la relation profonde et intime que Jésus appelle « la connaissance ». Il ne pourra pas reconnaître comme son enfant, celui qui n’a pas cherché à nouer des liens étroits avec lui, dans une mise en pratique de sa Parole, pleine d’amour et de reconnaissance. La connaissance selon la Bible implique une expérience réelle et personnelle de ce que l’on a appris. Cela ne peut pas rester au seul niveau cognitif, intellectuel, qui ne transforme pas le cœur.

En illustration de cet enseignement, la parabole des deux maisons est introduite par la coordination « donc, ainsi ». La mise en garde est rendue plus frappante par l’image. La « prudence » de l’un contraste avec le manque de sens ou d’intelligence de l’autre. L’insensé apparaît comme celui qui n’a pas pensé qu’il était responsable de sa vie devant Dieu et qu’il y avait des conséquences à ses choix. Le « prudent ou sage » au contraire sait que Dieu existe (Ps 53.2) et conforme sa vie à des lois dont il a reconnu le bien-fondé pour sa vie. Le « roc » peut être compris comme la Parole de Dieu, qui ne change pas et qui offre un soutien dans toutes les circonstances heureuses ou difficiles. Plus largement, on y voit le Christ lui-même (Ps 71.3á; 1 Cor 10.4).
Construire sa vie en s’appuyant sur lui, en suivant ses lois d’amour et de service des autres, que l’Esprit a écrites dans le cœur, c’est commencer dès ici-bas sa vie éternelle. Mais ignorer ou négliger la Parole de Dieu, c’est se fonder pour sa vie, sur ses impressions, ses pulsions, ses propres jugements, fluctuants et instables comme le sable mouvant. Sous une autre forme on retrouve ici le récit de la chute d’Adam et Eve qui choisirent d’écouter leurs désirs au lieu de la Parole divine (Gen 3. 6). Lorsque l’épreuve survient, on n’a plus de références, de repères solides pour agir sagement et on court au fiasco.
Selon cette parabole, la mise en pratique de la Parole de Dieu demeure le critère du jugement final, car c’est par les actes que l’on peut déceler la vraie foi en Jésus qui sauve et connaît les cœurs. (Voir Jac 2.18 ; mais aussi Rom 2.13-16). Par sa connaissance des cœurs, Jésus distingue les œuvres de façade des œuvres de foi et d’amour.
Questions pour une application dans la vie chrétienne
- Sur quoi se fondent mes actes de piété : une obéissance servile aux lois divines par crainte du jugement ou par vaine gloire ? une obéissance joyeuse, dynamique, librement vécue dans la reconnaissance pour le pardon reçu et le salut acquis par Jésus ?
- Quelle place tient dans ma vie de piété le regard des autres sur moi ? Comment ne pas tomber dans la recherche du spectacle ou de l’admiration ?
-Citez quelques paroles divines dont vous avez expérimenté le secours, le réconfort et la puissance de discernement dans la tempête des épreuves de votre vie.
08:00 Publié dans Christ et Loi | Lien permanent | Commentaires (0)