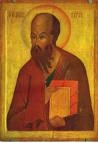26/04/2017
Etude n°5 Vivre pour Dieu 1 Pierre 4. 1-11 (06 05 17)
En réponse à la demande de certains de nos lecteurs qui suivent le manuel adventiste mondial des études hebdomadaires de la Bible, voici la publication du texte de l'étude n°5 de ce manuel, qui sera partagé dans les églises ce 29 avril.
Étude n°5 : Vivre selon Dieu, 1 Pie 4.1-11 (29 04 17)
« Que dès maintenant vous viviez le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains» 1 Pie 4.2 (BFC)
Observons
Le texte 4.1-11 :
- A quel verset précédent se rattache la conjonction « donc » du v 1 ? Quelle exhortation introduit-elle ?
- Quelle expression est répétée trois fois dans les v 1-2 ? Que signifie-t-elle pour Pierre ?
- Quelle pensée doit armer le croyant dans la souffrance ? (le « car » de certaines versions est l’équivalent de nos deux points (:) en français. Qui représente le « celui qui a souffert » ? Lire Rom 6.6-7 ; 8.10-11.
- Comment le v 2 éclaire-t-il le v 1 ? De quelle souffrance s’agit-il ? Comparer avec 1.11 et 3.18.
- Pourquoi le croyant doit-il s’armer ? Qu’est la vie du croyant selon cette image ?
- En contraste avec les croyants, quelle est l’attitude des non-croyants ? (v 3-4)
- Avec quelle conséquence ? (v 5)
- Comment peut s’entendre l’expression « les vivants et les morts » ? (v 5)
- Quelles parallèles contient le v 6 ? Comment ces parallèles donnent-elles sens à la fin du verset ? voir Rom 8.10-11.
- De quels morts s’agit-il ? Quand ont-ils été évangélisés ? Dans quel but
- Par quoi se termine l’exhortation de Pierre (v 7) ? Comparer avec 1 Thes 5.4-6 et 1 Pie 2.9 ; 5.8.
- V 8-11 : Comment Pierre définit-il la vie selon Dieu ? Comment le chrétien glorifie-t-il Dieu ? Quels dons a-t-il reçus pour cela ? (Rom 12.6 ; 1 Cor 12.7-10).
Comprenons
Le texte
Sa parenthèse terminée (voir l’étude n°6 déjà publiée), Pierre reprend son argumentation en liant les v 3.18 et 4.1 par la coordination « donc ». Au ch 2.21-24, il a déjà donné en exemple l’attitude de Christ dans la souffrance et la mort injuste de la croix. C’est ce qu’il reprend ici dans l’expression répétée trois fois « dans la chair ». Souffrances et mort sont équivalentes : Christ a souffert et a subi la mort dans sa chair d’homme, dans sa nature humaine qu’il avait endossée volontairement (Phi 2.7-8). Une fois cette nature humaine mise à mort dans son corps sur la croix, Christ a été libre du péché et a rendu l’homme libre de son emprise (Rom 6.6-7 ; 1 Pie 4.1b). Par sa résurrection, Christ a donné à l’homme une nouvelle nature « spirituelle » (= dirigée par l’Esprit), semblable à la sienne, qui lui permet de vivre selon la volonté de Dieu (v 2). Une erreur funeste de lecture a fait croire à partir de ces deux versets que la souffrance était salvatrice, et rendait « saint » (= « celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché », v 1c). Pierre cherche seulement à encourager les chrétiens dans la souffrance des persécutions pour qu’à l’exemple du Christ « mort au péché » dans sa chair, et ressuscité par l’Esprit, ils fassent mourir les désirs charnels de leur nature humaine non régénérée (4.2), et vivent pour Dieu, pardonnés, purifiés et transformés par la puissance de l’Esprit à son image (voir 2 Cor 3.18).
L’argumentation de Pierre n’est pas facile à suivre : Pierre était un homme simple et non un lettré comme Paul. Il possédait mal la langue grecque et avait besoin d’un secrétaire pour écrire sa lettre (5.12). Sylvain ou Silas, avait été d’abord le compagnon de Paul (Act 15.40 ; 16.25), comme Jean-Marc (= Marc l’évangéliste). Tous deux ont ensuite rejoint Pierre. Ceci explique l’influence sur Pierre de la pensée paulinienne, dans la transcription condensée de cette lettre par Sylvain.
Pierre oppose à l’attitude ferme et droite du croyant, les « désirs humains », égocentriques et matérialistes de l’incroyant. Ce dernier non content de satisfaire ses appétits de jouissance, voudrait y entraîner le croyant dont la maîtrise de soi et les aspirations spirituelles lui sont totalement étrangères. Il se sent jugé par la conduite irréprochable du chrétien et l’abandon de son ancienne vie. En réaction, l’incroyant calomnie les croyants et blasphème contre Dieu (v 4c), ignorant que Dieu est son juge, et préférant les ténèbres à la lumière (Jean 3.19).
L’expression « juge des vivants et des morts » peut désigner littéralement tous les hommes en général, quelle que soit l’époque de leur vie. Les premiers chrétiens s’inquiétaient en effet du sort des croyants décédés avant le retour de Jésus. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens (4.13-18) Paul avait répondu à cette angoisse, en affirmant que les morts dans la foi attendaient dans le sommeil inconscient du tombeau le retour de Jésus qui les ressusciterait et les rassemblerait avec les vivants du moment, pour constituer son Royaume. Pierre peut aussi employer l’expression symboliquement, les vivants représentant les croyants et les morts désignant les incroyants. C’est un peu plus difficile à admettre lorsqu’on lit dans Jean 3.18, que « celui qui croit au Fils n’est point jugé » !
Les deux parties du v 6 mettent en parallèles « morts // jugés selon les hommes quant à la chair » opposé à « évangélisés // vivants selon Dieu par l’Esprit » : l’évangile a été prêché de leur vivant à ceux qui physiquement sont morts au moment où Pierre écrit. Leur mort physique a manifesté le jugement de leur état d’hommes pécheurs, solidaires du genre humain. Mais la Bonne Nouvelle qu’ils ont acceptée leur a acquis la vie éternelle, qu’ils ont commencée dès ici-bas en vivant selon la volonté de Dieu, par la puissance de son Esprit. Selon la conception biblique de l’homme, il n’y a pas dualité en lui entre le physique (= la chair) et l’intellect ou le spirituel (= l’esprit). Il nous faut donc comprendre le « pneumati » de la fin du verset 6 comme désignant l’Esprit de Dieu, qui anime le croyant et s’oppose à sa nature charnelle et mortelle (= la chair = l’homme tout entier). Le conflit interne de l’homme n’est pas entre son corps et son esprit, mais entre l’Esprit de Dieu et sa nature humaine pécheresse (Rom 8.2).
Pierre conclut son exhortation (v 7) par une recommandation de modération, de sobriété dans la conduite, et de prière, pour rester debout à l’avènement proche de Christ. Ce retour mettra fin au grand conflit spirituel entre Dieu et Satan, dont les hommes sont l’enjeu, consciemment ou non (2 Pie 3.8-12). Par la prière persévérante, le croyant s’arme contre la tentation de se laisser aller à l’influence du monde ambiant (Luc 22.46 ; Marc 14.38) Il prend contact avec Christ qui lui envoie son Esprit pour vivre en communion avec Lui.
V 8-11 : Pierre résume la vie pour Dieu du chrétien en trois mots : amour constant, hospitalité sans murmures, service des autres. Le chrétien, en « bon intendant de la grâce de Dieu », est appelé à gérer ses dons pour honorer le Seigneur tout-puissant en paroles et en actes dans ses relations avec les autres.
Questions pour une application dans la vie chrétienne
-En quoi la souffrance de la persécution pour Christ peut-elle nous libérer du péché (v 1) ? Faut-il beaucoup souffrir pour être « saint » ? La souffrance servirait-elle à gagner le salut ? Que faire de cette souffrance injuste ?
- Par quelles souffrances et quelle mort le chrétien doit-il passer pour vivre selon l’Esprit et la volonté de Dieu ? (voir Jésus à Gethsémané)
- La perspective du retour proche de Jésus change-t-elle quelque chose à ma vie de foi et à ma conduite ? Dans quel état d’esprit l’envisagé-je ?
- De quel(s) don(s) l’Esprit m’a-t-il doté ? Comment puis-je l’(es) utiliser pour vivre selon Dieu et le glorifier en toutes choses ?
- Comment ma vie manifeste-t-elle que je suis au service de Dieu et non de moi-même?
14:12 Publié dans Pierre | Lien permanent | Commentaires (0)
16/04/2017
Pâques 2017
Christ est ressuscité, vraiment ressuscité !
Que sa vie transforme la nôtre, et nous remplisse de l'espérance d'une vie éternelle dans son amour et sa lumière !

Résurrection dans le Retable d'Isenheim par Grünewald (Colmar,16ès)
06:00 | Lien permanent | Commentaires (1)