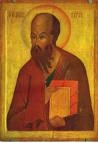21/03/2025
Étude n°13 Romains 13.8-14 et Jérémie 31.31-34 L’amour est l’accomplissement de la loi (29 03 25)
Pour terminer ce trimestre , nous vous offrons le choix entre deux textes : dans le Nouveau Testament : Romains 13.8-14 et dans l'Ancien Testament Jérémie 31.31-34
1- Premier texte
Étude n°13 Romains 13.8-14 L’amour est l’accomplissement de la loi (29 03 25)
« Ne devez rien à personne si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; celui qui aime les autres a accompli la loi. » Romains 13.8
Observons
Le contexte :
Après la partie doctrinale de sa lettre, Paul exhorte les chrétiens à vivre selon Dieu (ch 12), en insistant sur les relations fraternelles remplies d’amour (12. 9-10, 16-17, 20-21). Le ch 13 débute avec le sujet des relations avec les autorités : (v 2, 4) Que représentent les autorités pour Paul ? Comment le chrétien doit-il se comporter vis-à-vis des autorités ?
Le texte : se compose de trois parties :
V 8-10 : Amour et Loi : Quels commandements cite Paul ? Pourquoi ? Quel rapport fait-il entre amour et loi (v 8, 10)?
V 11-12 : Sur quoi se fonde l’exigence de l’amour ? Quelle opposition contient le v12 ?
V 13-14 : Que signifie « honnêtement » ? Par quelle image Paul conclut-il le passage ? A quoi l’oppose-t-il ?
Comprenons
Le contexte
Le paragraphe sur la soumission aux autorités se situe au centre des deux développements sur l’amour fraternel. Autant dire que cet amour doit aussi concerner les relations avec les autorités ! Comme Paul avait conclu le ch 12 sur la recommandation de « vaincre le mal par le bien », il ne pouvait pas laisser de côté la relation avec les autorités, qui est comme à notre époque aussi, une question essentielle de la vie du citoyen. La raison d’être des autorités est de veiller au bien de la vie en commun dans la cité, ou l’église. Pour Paul c’est Dieu qui les a instituées pour établir l’ordre et exercer la justice. (Voir l’exemple de Moïse et Jethro Exode 18). S’opposer aux autorités, serait donc s’opposer à la volonté de Dieu. Ce précepte doit être appliqué toutefois avec discernement de la volonté de Dieu. Pierre a su en Actes 4.19 et 5.29 donner les limites de l’obéissance aux autorités : lorsqu‘elles donnent des ordres contraires à la volonté divine, « il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes » ! Paul ne pose pas ici la question de savoir à quel moment le chrétien doit se soumettre à une autorité prise par la force et qui change le régime de l’Etat. Comment se soumettre à un pouvoir fondé sur le crime, c’est pourtant ce que vivaient les Romains sous Néron à l’époque de Paul ! Pour autant le chrétien doit-il rester passif et muet devant les injustices flagrantes ou s’engager pour rétablir le droit ? Paul n’est pas un révolutionnaire ni un politique. Il se place plutôt sur le plan du principe spirituel que Jésus avait émis en Marc 12.13-17 « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu ». Peut-on comprendre le v 7 dans le contexte des Romains (et le nôtre !) : « Gardez respect, honneur et obéissance aux autorités, tant qu’elles n’empiètent pas sur votre vie avec Dieu et vos relations fraternelles avec les autres » ?
Le texte v 8-14
8-10 : L’apôtre enchaîne avec les relations fraternelles où l’on ne doit rien aux autres si ce n’est de l’amour. La Loi divine avec ses deux tables(les 4 premiers commandements concernant la relation à Dieu, et les 6 autres les relations aux autres) a été résumée par Jésus en deux commandements d’amour « Tu aimeras le Seigneur Dieu… et tu aimeras ton prochain comme toi-même ! ». L’obéissance à ces commandements est donc aimer ! Ici Paul ne s’occupe que de la seconde table de la loi qui concerne les relations humaines, et la résume en affirmant qu’aimer c’est ne pas faire de mal à autrui. On retrouve la même idée émise en 12.21 : « Sois vainqueur du mal par le bien ».
Aimer l’autre comme soi-même implique d’abord de reconnaître à l’autre la même valeur que l’on s’attribue à soi-même, ou plutôt que Dieu attribue à chacun : « Luc 12.7, 24 : Vous valez plus que les oiseaux ! » et Psaume 8. 6 : « Tu as fait l’homme de peu inférieur à Dieu ! ». Lui faire du bien c’est chercher ce qui contribue à son bien physique, moral, affectif et spirituel, en oubliant son propre égoïsme, son propre intérêt et son orgueil, à l’exemple de Christ (Phil 2.5). Aimer ne consiste pas simplement à le dire, mais à agir en faveur de l’autre.
11-14 : A l’époque de Paul (environ 60 ap JC) on croyait que le retour de Jésus était imminent. C’est pourquoi l’apôtre rappelle aux chrétiens l’urgence de se démarquer du monde ambiant, plongé dans les ténèbres spirituelles de l’ignorance de la venue de Christ en gloire, et dans les ténèbres morales de comportements néfastes à la relation entre les hommes, et à l’épanouissement de la personne (v 13). Le chrétien ne peut s’endormir comme les cinq vierges folles de la parabole (Matthieu 25) car il sait que Le Seigneur reviendra à l’heure où on ne l’attend pas. Le chrétien est appelé à sortir du sommeil, de la léthargie de ses habitudes ou traditions, de l’aveuglement sur le moment présent, de l’ignorance ou l’inattention aux signes des temps dont Jésus a dit « Quand vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes car votre délivrance (= salut,v 11) est proche » Luc 21.28,31)
12-14 : Revêtir les armes de la lumière, ou armes du soldat de Dieu (Ephésiens 6.11-18) permet de « marcher honnêtement », c’est à dire de façon à ne rien cacher, sans hypocrisie ni mensonge, sans chercher à paraître au lieu d’être, sans rechercher la satisfaction de ses intérêts avant ceux des autres. Paul assimile ces armes de lumière au vêtement de Christ dont Dieu nous revêt : la justice et la sainteté de Christ couvrent notre être naturel pécheur (= la chair et ses convoitises, v 14) et nous permettent de progresser dans la « sainteté » (dans la sanctification) jusqu’à la stature parfaite de Christ (Ephésiens 4.13). Un programme de vie chrétienne qui nous distinguera dans le monde, et fera connaître à travers notre témoignage de vie tout l’amour de Dieu pour chacun.
Questions pour une application dans la vie chrétienne
- De quelle(s) infraction(s) à la Loi de Dieu, l’Esprit m’invite-t-il à prendre conscience, et à demander pardon ? Qu’est-ce que dans ma vie, je redoute d’être mis en lumière ?
- Qu’est-ce qui m’empêche d’aimer l’autre comme moi-même ?
- De quelle arme de lumière ai-je besoin pour grandir dans la sainteté ?
Second texte
Jér 31.31-34 L’Amour est l’accomplissement de la Loi (29 03 25)
« L’amour ne fait pas de mal au prochain, l’amour est l’accomplissement de la Loi » Rom 13.10
Observons
31-32 : Comment est qualifiée l’alliance que Dieu propose à son peuple ? De qui est composé ce peuple ? A quoi s’oppose cette alliance (v32) ?
33 : Que signifie la place de ce verset dans le passage ? Quelles sont les caractéristiques de l’alliance proposée par Dieu ? En quoi s’opposent-elles à l’ancienne ?
34 : Quels seront les fruits de cette alliance ? Qu’est-ce qui en est le plus important ? (voir la place au centre du verset). De quoi se compose la connaissance de l’Eternel ?
Comprenons
Le contexte
Dans sa lettre aux captifs exilés à Babylone, Jérémie s’emploie à leur redonner l’espoir d’un retour à Jérusalem. L’Eternel reste au milieu du peuple même loin du temple, il guérira (30.17), il délivrera (31.7), il donnera un avenir (31.17), rafraîchira l’âme altérée, rassasiera l’âme languissante (31.25). Ils n’auront plus à subir les conséquences du péché de leurs pères, dont l’idolâtrie les a menés à l’exil (31.30) ; chacun sera devenu responsable de son sort.
Le texte :
Alors que Jérémie s’adresse à Juda seul, la proposition d’alliance nouvelle avec Dieu concerne tout le peuple, Israël exilé et dispersé depuis une centaine d’années (721, chute de Samarie) et Juda en passe de suivre le même sort. Dieu ne veut laisser personne hors de son alliance, Il n’oublie ni ne favorise personne.
L’alliance sera nouvelle car l’ancienne, scellée au Sinaï après la sortie d’Égypte, a été rompue par le peuple. L’auteur de la lettre aux Hébreux, reprend ce passage plusieurs siècles après Jérémie (Hé 8.7-13), pour montrer que la désobéissance à la loi de Moïse qui avait été écrite sur des tables de pierre de façon à être indélébile, a rendu caduque une alliance restée extérieure à chacun. La loi et ses rites cérémoniels pratiqués littéralement sans en comprendre le sens profond, n’étaient « qu’une ombre et une figure des réalités spirituelles », que Christ est venu révéler pleinement (Hé 9.5,9-10 ; 10.1).
Cette nouvelle alliance sera rendue possible par le pardon total de Dieu (v34c) acquis par l’unique sacrifice de Jésus (Héb 9.14, 26 ; 10.14). Pardonné et purifié dans son être intérieur (= cœur), le pécheur repentant et régénéré, reçoit la loi divine comme boussole de sa vie pour ne pas s’écarter de l’alliance avec Dieu. Le peuple de Dieu devient alors l’ensemble de ceux qui « connaissent » Dieu, c’est-à-dire ceux qui ont une relation intime personnelle avec Lui, rendue possible par le pardon divin. Nul ne peut s’y prévaloir d’une connaissance supérieure à l’autre (v 34a), car chacun cultive cette intimité dans son cœur.
Jérémie et ses contemporains, tout préoccupés par la perspective d’un retour à Jérusalem, n’ont sans doute pas perçu la dimension messianique et spirituelle de cette prophétie que Jésus a pleinement accomplie. Il faudra l’inspiration de l’Esprit Saint aux apôtres pour commencer à entrevoir la nature spirituelle de l’alliance nouvelle.
Il est évident aussi qu’au-delà de la nouvelle alliance scellée par Jésus-Christ, le tableau prophétique de ce verset 34, n’est pas encore réalisé. Il trouvera sa plénitude dans le Royaume éternel, lorsque le péché aura disparu, et que les hommes suivront la loi de Dieu tout naturellement dans leur être ressuscité et glorifié. En attendant, Dieu invite chacun à entrer de tout son cœur dans son alliance d’amour qu’a inaugurée Jésus-Christ ; par sa mort sur la croix, il nous assure « de son pardon et de l’effacement de nos péchés » (Jér 31.34c).
Questions pour une application dans la vie chrétienne
- Par mon baptême j’ai fait alliance avec Dieu ; mais quelle alliance ? L’engagement à l’obéissance scrupuleuse de la loi, ou la demande d’une « conscience purifiée par Dieu » (1 Pie 3.21) ?
- Comment la loi peut-elle être écrite dans le cœur ?
- Le pardon de Dieu m’est-il acquis gratuitement, ou me faut-il obéir pour être « en règle avec Dieu » ?
- Comment approfondir ma « connaissance » de Dieu, ma relation intime avec Lui ?
- Est-il utile ou possible de partager cette connaissance avec d’autres ? Comment et pourquoi ?
08:00 Publié dans Amour et Justice de Dieu 1 tri 25 | Lien permanent | Commentaires (0)
14/03/2025
Étude n°12 Luc 10.25-37 Les deux plus importants commandements (22 03 25)
Étude n°12 Luc 10.25-37 Les deux plus importants commandements (22 03 25)
« On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l’Éternel demande de toi : c’est que tu pratiques le droit (la justice), que tu aimes la loyauté (la miséricorde) et que tu marches humblement avec ton Dieu » Michée 6.8
Observons
Le contexte :
Après avoir envoyé en mission soixante dix de ses disciples, Jésus s’est réjoui de la révélation de Dieu qu’ils ont reçue par Lui, alors qu’ils ne sont pas des sages imbus de leur intelligence et de leurs connaissances (v21-24).
Le texte
a) V 25-29: dialogue entre un docteur de la loi et Jésus :
- Quelle est l’intention du docteur de la loi ?
- Comment sa question révèle-t-elle la préoccupation des Pharisiens ?
- A quoi le renvoie Jésus ? Pourquoi ?
- V 29 : De quoi et Comment le docteur de la loi cherche-t-il à « se justifier » ?
b) V 30-35 : réponse de Jésus par une parabole :
- Relever les verbes qui permettent de camper la situation (v30), Que représentent les différents personnages des versets 31-32 ? Comment leur fonction explique-t-elle leurs actes ?
- Qui est le quatrième personnage mis en scène en opposition aux trois autres ? Quels sont ses actes ? En quoi sont-ils extraordinaires de sa part ? (v 33-35)
a') V 36-37 : reprise du dialogue et envoi
- Comment Jésus reprend-il le dialogue ? Comment retourne-t-il la question initiale du docteur de la loi? Que cherche-t-il à obtenir de lui ?
- Comment sa conclusion répond-elle au docteur ? (v 37b)
Comprenons
Le dialogue entre Jésus et le docteur de la loi.
En contraste avec la simplicité de cœur des enfants que Jésus avait louée, une rencontre avec un docteur de la loi va démontrer la duplicité de l’âme humaine face à Jésus : le docteur de la loi ne vient pas à Jésus pour apprendre de lui réellement comment être sauvé, car il connaît la loi par cœur (v 27) et croit que cela suffit. Il cherche plutôt à éprouver Jésus, à le prendre en défaut, pour discutailler avec lui de tel ou tel point de doctrine et de comportement.
La question du maître de la loi est inspirée par un sentiment de propre-justice et se place sur le registre du « Faire ». Au v 23, Jésus avait dit à ses disciples que pour voir Dieu, il ne s’agissait pas de « faire » mais « d’ouvrir les yeux ». Cette expression dans la Bible est toujours synonyme d’accès au monde spirituel. Pourtant Jésus renvoie le docteur de la loi à ce qu’il connaît, les Écritures. La première question posée par Jésus fait appel non seulement à la mémoire du docteur de la loi, mais aussi à sa réflexion, à son intériorisation des termes de la loi. Le docteur a bien compris l’essence même des Écritures, la loi d’amour de Dieu et du prochain, empruntée à Deutéronome 6.5 et Lévitique 19.18.
Jésus renvoie aussi le légiste à sa conscience sur le même registre de langage « Fais cela et tu vivras », car il sait que la loi révèle l’incapacité à « faire » et conduit à la repentance devant Dieu.
Le v 29 montre que le maître de la loi a saisi l’intention de Jésus ; sa conscience sans doute le travaille et l’accuse d’infidélité à la loi, de manque d’amour pour Dieu et son prochain. Se sentant accusé, il cherche à se justifier, à trouver une excuse. Au lieu de se tourner vers Jésus en lui demandant « Comment aimer ainsi ? », ce qui serait un aveu d’impuissance humiliant à ses yeux, il se jette sur une question théologique « Qui est mon prochain ? », question qui était un piège pour Jésus car les scribes et les pharisiens considéraient les Juifs comme seuls prochains possibles. Les étrangers étaient exclus. Si Jésus répondait « tout homme », le maître de la loi l’aurait accusé d’être en contradiction avec leur doctrine.
Jésus répond par la parabole du Bon Samaritain, qui retourne la question non pas sur l’autre mais sur soi : « Lequel te semble avoir été le prochain du blessé ? », de sorte que le maître de la loi devait se demander : « Le suis-je, moi ? L’aurais-je été à la place du Samaritain ? » Ressembler au Samaritain lui paraît tellement impensable à cause des préjugés raciaux et religieux à l’égard des Samaritains, qu’il n’ose même pas en prononcer le nom. Il use de la formule générale : « Celui qui a exercé la miséricorde ! »
Jésus rompt la conversation en l’invitant à ne pas se contenter du savoir, mais à le mettre en pratique « Va et fais de même ! »
Il n’ajoute pas comme au v 28 « Et tu vivras », car ce ne sont pas les actes de charité qui sauvent. Les païens peuvent en faire autant par humanité ou désir de paraître. Le croyant les accomplit parce qu’il est rempli d’humilité devant Dieu, et poussé par l’amour de Dieu, son Sauveur, qui le conduit à aimer l’autre et à éprouver de la compassion pour lui ; il ne cherche pas à gagner son salut par de bonnes actions.
Interprétation littérale de la parabole
Le chemin descendant de Jérusalem à Jéricho traverse une région montagneuse et désertique où les attaques de brigands étaient fréquentes. Le voyageur de la parabole subit un sort de plus en plus tragique dont la progression va de mal en pis : attaqué, volé, dénudé, battu et abandonné à demi-mort.
Le prêtre et le lévite, par leur connaissance des Écritures et de la loi de charité, auraient dû être les premiers à l’appliquer. Mais ils sont retenus par la conscience de leurs fonctions dans le temple qui exigeaient d’eux la pureté rituelle et leur interdisaient de se souiller en touchant un mort : la haute idée de leur personnage et de leur fonction passe avant la loi d’amour, et les fait changer de côté de la route. À cela s’ajoutait peut-être la peur de subir le même sort que cet homme, s’ils s’attardaient dans les parages.
Le Samaritain était un homme méprisé et haï de tout bon Juif. Il aurait pu voir dans le malheureux blessé non seulement un étranger, mais un ennemi enfin abattu ! Au lieu de cela, il écoute la voix de son cœur et s’occupe de lui avec le plus grand soin, jusqu’au bout de ses capacités, sans regarder à la dépense, appliquant à cet homme l’amour qui est demandé pour Dieu : de tout son cœur, son âme, sa force, sa pensée. C’est une belle leçon d’humanité, de dévouement désintéressé, d’ouverture à l’autre sans préjugé ni racisme.
Mais si on en reste à cette lecture, on demeure dans le domaine du « faire », de la morale, de la conduite extérieure, nécessaire mais pas suffisante pour vivre une relation vraie avec Dieu.
Interprétation symbolique et spirituelle
A travers cette parabole, Jésus enseigne toute l’histoire du salut.
Le chemin de Jérusalem à Jéricho symbolise le chemin de la vie de tout homme, ou de l’humanité entière. De la communion avec Dieu que représentent Jérusalem et son temple, l’homme est descendu de plus en plus bas en s’éloignant de Dieu. Il a été attaqué par Satan l’Adversaire, s’est fait voler la domination du monde que Dieu lui avait confiée (Genèse 1.28). Il a été dépouillé du vêtement protecteur de la lumière et de la présence de Dieu, et s’est retrouvé nu = livré à lui-même, déchiré par la honte, la violence de ses passions et de ses révoltes, promis à la mort physique et spirituelle (Genèse 3.1-13).
Le prêtre et le lévite qui passent sans secourir, peuvent symboliser l’état d’esprit des religions humaines face au problème du mal : elles sont plus motivées par le désir de pureté personnelle et par la peur de mourir, que par un véritable amour des autres qui pousse à s’oublier soi-même pour sauver l’autre. Les religions humaines sont totalement inefficaces pour sortir le pécheur de sa « mort » causée par sa séparation d’avec Dieu.
Il n’y a qu’une seule voie de salut, Jésus, symbolisé par le Samaritain. Il est méprisé par son peuple qui le considère comme étranger venu d’ailleurs, de Galilée (Jn 1.46). Pourtant, c’est lui qui est touché par l’état de l’homme blessé et à demi-mort dans son péché (= sa séparation de Dieu). C’est lui qui s’approche du pécheur au risque de sa propre vie, verse l’huile de sa grâce pour apaiser la souffrance de sa culpabilité, et le vin de son Esprit pour purifier (= désinfecter les plaies) l’être tout entier blessé par le mal. C’est lui qui recouvre le pécheur du pansement de sa justice et de son amour.
Il est aidé dans cette tâche par son âne, serviteur fidèle qui représente tous les disciples qui suivent leur Maître « partout où il va » (Apocalypse 14.4), pour Le porter vers les autres (= le faire connaître), ou collaborer concrètement à son œuvre de salut des autres.
Jésus, ayant pris soin personnellement du pécheur, secondé par un disciple dévoué, le confie à l’hôtellerie qu’est l’Église qui prendra le relais, jusqu’à ce qu’il revienne. A son Église, Jésus donne les deniers de son Esprit pour remplir sa tâche avec efficacité et persévérance auprès des pécheurs. L’Église est composée d’un ensemble d’hôteliers qui ont tous la même tâche d’accueillir, prendre soin, nourrir les pécheurs repentants qui ont bénéficié du salut de Christ.
Jésus leur promet de combler tout ce qui pourrait leur manquer dans cette tâche, dès à présent par les arrhes de son Esprit, et dans l’éternité par la plénitude de sa présence dans son royaume.
Quand Jésus renvoie le docteur de la loi en l’invitant à être et agir comme le Samaritain, il renvoie chacun de nous à sa position face à Dieu et face à lui, le Christ. Il invite chacun à réfléchir sur qui il veut être dans le plan du salut, chacun des acteurs de cette histoire représentant une attitude spirituelle possible dans la relation avec Dieu.
Questions pour une application dans la vie chrétienne
- Pourquoi Jésus enseigne-t-il par paraboles ? Qu’est-ce que cela ajoute à son enseignement ? Est-ce un moyen encore valable aujourd’hui pour faire comprendre les enseignements bibliques à nos contemporains ?
- Comment actualiser la parabole du Samaritain en en gardant toutes les nuances ?
- A quel personnage puis-je m’identifier dans ce récit ?
- D’après cet exemple, qu’est-ce qui pouvait faire autorité dans l’enseignement de Jésus, par rapport aux enseignements des scribes et docteurs de la loi ?
- Comment aujourd’hui puis-je vivre concrètement ces deux commandements d’amour de Dieu et d’amour du prochain ?
08:00 Publié dans Amour et Justice de Dieu 1 tri 25 | Lien permanent | Commentaires (0)